|
|
|
|
| |
Parution de l'ouvrage "Djenné-ferey, la terre habitée" (novembre 2007)
|
| |
L’association DJENNE PATRIMOINE. s'occupe de la protection et de la promotion du patrimoine archéologique, architectural et culturel de la ville de Djenné, la plus ancienne ville connue au sud du Sahara, fondée au IIIème siècle avant J.C.
Notre collègue Joseph Brunet-Jally est l'un des animateurs de cette association qui nous informe que l’ouvrage "Djenné-ferey, la terre habitée" vient de paraître.
Il s'agit d'une sélection de photos de Marli Shamir, prises dans les années 1970 à Djenné et dans les environs. Chaque photo est accompagnée d'un court poème d'Albakaye Ousmane Kounta, poéte malien, et le poéme "Des piliers plein les mains d'argile" termine le livre. Enfin, il fallait expliquer au lecteur ce qu'est le "djenne-ferey". C'est notre collègue Joseph Brunet-Jailly qui s'en est chargé, dans une introduction très complète.
Quelques exemplaires de ce beau livre sont vendus au profit de l’Association
DJENNE PATRIMOINE. L’ouvrage peut être commandé à DJENNE PATRIMOINE 6 rue de Ceyra, 63000-Clermont-Ferrand, France au prix de 38€ payés par chèque à l'ordre de DJENNE PATRIMOINE*
|
|
|
« Suivez-moi jusqu’à Djenné, au-delà de ses murs austères ! »
Introduction à l'ouvrage par Joseph Brunet-Jailly
C’est une fenêtre qui ouvre ce livre. Une de ces petites fenêtres si bien décorées et si bien fermées de volets qu’elles ne laissent passer que peu de lumière, une de ces fenêtres dont on dit qu’elles dérobent les femmes au regard des passants, une de ces fenêtres qui aussi bien aiguisent la curiosité des prisonnières à l’égard du monde extérieur. Or, justement, tous et chacun, nous sommes prisonniers de notre monde, tous et chacun nous sommes invités à découvrir le vaste monde au-delà de ce que nous en connaissons.
Ici, c’est un monde matériel que, d’abord, nous découvrent ces images. Non pas le monde naturel, des rochers, des plages ou les immensités d’un désert, mais un monde fait de main d’homme ! Un monde de hauts murs aux décors uniques, un monde fait de la matière la plus humble qui soit, la terre crue, la terre sèche, élevée, modelée, parée avec un art consommé. Un monde de maisons aux façades austères, au charme pourtant saisissant, délimitant des ruelles étroites, très paisibles, vides en apparence de toute vie.
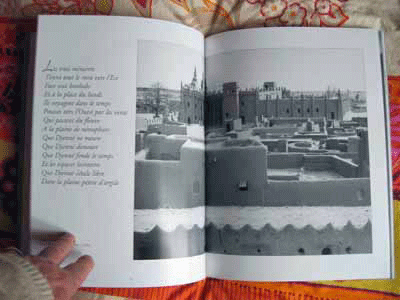
En effet, l’un des caractères de la sélection que Marli Shamir a faite de ses photos, c’est le grand nombre de celles sur lesquelles n’apparaît aucun être vivant : le plus souvent, l’image est consacrée, avec un grand soin, à décrire ces créations humaines à vrai dire essentielles, l’habitat et les lieux de culte. Construire n’est évidemment pas banal dans ces immenses pleines alluviales où la moindre place pérenne où édifier un abri a dû être gagnée sur les eaux, à force d’occupations temporaires terminées par un désastre, tout étant emporté par des eaux furieuses et implacables, à force d’occupations précaires nouvelles, à force de reconstructions, à force de volonté et de sacrifices, et même à force de sacrifices humains, nous dit une légende qui ne ment probablement pas ! (La légende de Tapama, jeune fille bozo très belle, vierge et fille unique de se parents, sacrifiée aux divinités des eaux (propriétaires des lieux) sur ordre des djinns, pour éviter que les murs construits chaque jour ne s’effondrent au cours de la prochaine nuit.)
Oui, Marli Shamir est photographe d’architecture, elle le dit volontiers et nous devons la croire, tel était son métier, telle est bien la raison pour laquelle elle s’est si immédiatement attachée à l’architecture récente du Mali, et par exemple à la mosquée de San.
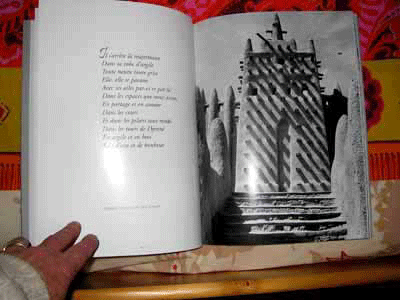
Mais Marli Shamir n’a pas photographié que des monuments, et elle a tiré de ses archives des portraits très attachants. Il faut donc s’en souvenir ici : la photographie d’architecture permet d’éviter ce qu’a de choquant, et même de scandaleux, l’attitude du photographe capable de voler le portrait de quelqu’un qu’il ne connaît pas et n’entend pas connaître. Tous ceux qui ont voyagé dans ce pays d’où viennent les images que Marli Shamir présente dans ce livre savent que les habitants y aiment être photographiés, mais ils savent aussi que, dans ce pays, rien ne peut être conclu dans la hâte : tout, à commencer par la plus simple demande (« quel est le chemin de tel village ? » par exemple) suppose d’abord longues, très longues, formelles, mais absolument nécessaires salutations, selon les façons de faire locales, puis des explications détaillées concernant le contexte, avant que la question elle-même puisse être prononcée. Alors, n’imaginez pas que vous ferez un portrait, une image d’une personne vivante, en échappant à un cérémonial, et en l’occurrence à un cérémonial encore plus complexe et plus long, celui qui peut établir une relation personnelle.
Et pourtant, si on a commencé par tout autre chose, par exemple, après les salutations et les nouvelles des familles et du voyage, par causer tout simplement de la vie des uns et des autres, par boire un peu d’eau fraîche au récipient qui vous aura été présenté, par se mettre au rythme de l’empathie, alors d’un coup plus rien ne s’opposera à ce que la séance de pose soit un plaisir partagé entre quelqu’un qui n’est plus un intrus, un grossier personnage, un malappris, mais qui, au contraire, est entré dans cet immense réseau de relations personnelles qu’entretient chacun dans une société où le capital de relations est la seule forme de capital, et quelqu’un qui n’est plus contraint, mais qui offre son portrait !
Nous pouvons donc imaginer que Marli Shamir a photographié beaucoup de monuments faute de pouvoir faire tous les portraits qui la tentaient. Nous pouvons imaginer qu’elle s’est approchée par petites étapes de ce pays auquel elle s’était senti immédiatement attachée : se cantonnant d’abord, par discrétion, par timidité, par compréhension intime des graves conséquences de l’inégalité des positions, dans la photographie d’architecture, avant d’en venir, à l’occasion, et de plus en plus au fur et à mesure que ses relations dans le pays devenaient plus nombreuses, plus équilibrées, plus confiantes, plus détendues, au portrait.
Toujours est-il que nous disposons d’un grand nombre d’images de ces chefs d’œuvre de l’architecture mondiale que sont les bâtiments civils de Djenné d’une part, la mosquée de Djenné et les mosquées de la région environnante d’autre part, celle de San tout particulièrement. Mais ensuite, les images s’animent, la vie apparaît autour de ces bâtiments, l’œil se déplace vers les métiers, puis vers les traditions : les fêtes donnent en effet l’occasion rêvée de contacts faciles, dans une ambiance débarrassée pour un temps des soucis de la vie quotidienne, de ses frustrations, et même d’une partie de ses inégalités. Et de là le chemin est bien court vers le portrait, ce document visuel le plus capable d’évoquer ce qu’est l’autre en lui-même. Tel sera donc notre cheminement dans les archives photographiques de Marli Shamir.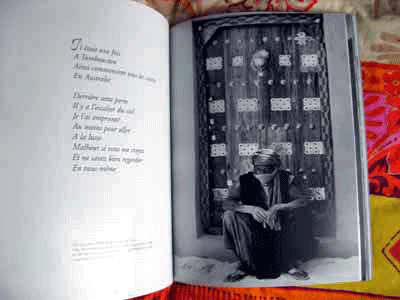
Ce cheminement est celui qu’a choisi le poète, conquis lui aussi. Son premier mouvement, pourtant, lorsque je lui avais parlé de photographies en noir et blanc, et datant des années 1970, avait été de me dire que, lui, il n’avait jamais eu la patience de faire des photographies, et qu’en outre il préférait les photographies en couleurs. Mais il s’est bien vite ravisé lorsqu’il a pu voir l’album des photographies dont il s’agissait. Albakaye Ousmane Kounta est un écrivain complet, qui s’est essayé avec un égal bonheur au roman, au conte et à la poésie. Il connaît par cœur le pays, ce pays, le Mali, pour conserver un souvenir exceptionnellement précis de chacun de ses nombreux voyages, de chacune des personnes rencontrées, de tout ce qui a ému sa sensibilité. Il peut reconnaître ici le four à pain, et vous expliquer où il se trouve exactement dans Tombouctou, il peut identifier telle personne et vous apprendre qu’il s’agit du gendre de Dupuis-Yacouba, il connaît ce pays par le cœur autant et plus que par ce qu’il y voit et ce dont il se souvient. Et donc, s’il s’est intéressé à ces images, ce n’est pas parce qu’elles représentaient pour lui une documentation nouvelle sur une monde exotique : c’est bien probablement –du moins je le présume– parce qu’il a perçu dans le regard du photographe, qu’il ne connaît que par ces travaux, une dimension qui va bien au-delà du plan, du document, le regard d’un autre qui s’est fait tout proche, un regard qui porte bien au-delà de ce qu’on voit d’abord.
C’est donc le cœur, aidé par un esprit subtil et par une profonde culture, qui parle déjà dans l’ordre proposé pour contempler les images. L’inquiétude est la première réaction devant ce monde où la vie n’est présente que par ses œuvres, ce qui est bien typique du monde matérialiste, qui produit tant de biens, et s’en enorgueillit, alors que la richesse matérielle n’est rien à côté de la richesse intérieure. Mais d’un autre côté ce monde matériel peut être vu comme la première étape d’une forme d’initiation, tant pour le prisonnier du Nord que pour celui qui désire s’approcher du Sud. Et Albakaye Ousmane Kounta sait, en divers domaines, découvrir une vérité cachée derrière une apparence, puis une nouvelle vérité cachée derrière la première vérité, elle-même bientôt apparue comme étape vers ce qu’elle cache et permet à l’esprit patiemment préparé de découvrir. Vous verrez comment, d’une photo de murs et de pinacles, il isole le nid de cigogne, exigu et haut perché, et passe de là à un message de fraternité universelle. Vous verrez comment il repère un regard trop adulte dans un portrait de jeune femme parée à un message d’espérance. Vous lirez comme son inspiration est profonde alors même que la forme est toujours simple et légère.
Il nous convie donc à observer l’architecture pour commencer, cette architecture de terre crue, de « banco », comme on dit ici. Une architecture célèbre dans le monde entier non pas tant pour ses prouesses (on ne construit pas ici aussi haut qu’au Yémen par exemple) que pour son style. Quel style en effet ! Car il ne s’agit pas moins que de mêler des héritages hétéroclites en une synthèse unique au monde : un héritage remontant très probablement aux traditions des premiers habitants de la zone, ces pécheurs aventuriers qui s’avançaient chaque année plus loin dans les immenses marécages riches en poisson, construisaient sur la moindre éminence un abri sommaire de paille et de bois, péchaient aussi activement que possible pendant que les eaux restaient basses, puis étaient obligés de fuir lorsqu’elles remontaient, emportant tout. Devant les terreurs de cette vie gagnée contre la nature, qui reprend souvent la vie ou les biens qu’elle a donnés, cette dernière est adorée pour ce qu’elle a de bénéfique : les eaux, le poisson, la puissance virile, la fécondité des femmes. L’architecture, qui apparaîtra lorsque les buttes anthropiques auront enfin accueilli durablement une population stable et diversifiée, n’hésitera pas à décorer les maisons des instruments de pêche, de puissants phallus, de symboles féminins et d’autres représentant la progéniture.
Mais ultérieurement une évolution considérable s’est produite sous l’influence de l’islam, marquée notamment par la construction d’une mosquée symboliquement édifiée sur l’emplacement de ce qui était auparavant le palais du roi Koy Konboro. Cette influence religieuse et culturelle déposait à Djenné des traces des civilisations antérieurement islamisées, celles de l’Afrique du Nord, de la Perse et de l’Arabie en particulier. Elle fut bientôt redoublée, quelques siècles plus tard, par la conquête marocaine : assurément cette armée n’était pas composée de beaucoup de pieux musulmans, mais elle apportait –et diffusa sur place, puisqu’elle se trouva rapidement coupée de ses arrières, et contrainte de se fixer– les traditions d’un pays à la riche culture, et en particulier des traditions architecturales qui se sont si bien implantées ici qu’elles y sont aujourd’hui encore parfaitement visibles. Une architecture qu’on dirait composite si l’on ne voyait pas que la synthèse qu’elle a réussie entre les éléments si divers qui l’ont inspirée est parfaitement originale, parfaitement équilibrée, donnant à voir des bâtiments majestueux, sobres et élégants, parfaitement adaptés à l’écologie du terroir.
Oui, d’abord l’architecture, même s’il peut paraître inquiétant de négliger la vie à ne considérer que sa trace. Marli Shamir l’écrit « l’architecture est une expression artistique extraordinaire du peuple malien »! Albakaye Ousmane Kounta part de l’architecture pour dévoiler ensuite la vie dont elle est issue et les qualités humaines de la société qui a si bien bâti. Il nous invite à découvrir ce pays par son architecture, et par une architecture d’exception tant dans ses réalisations civiles que dans les œuvres religieuses. Là le poète vibre au plus profond de lui-même, parce qu’il est croyant et chaque jour plus féru de connaissances religieuses : qui, mieux que lui, peut nous parler –serait-ce avec sa discrétion coutumière, car le lecteur aura déjà pu apprécier ce ton qui évite toute emphase– de ces images que seule la religion islamique justifie ?
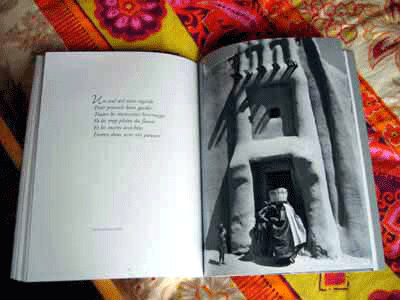
Et donc le poète commence son chant par ces mots « Suivez-nous à Djenné !». Car c’est à Djenné qu’au fil des siècles des populations très diverses se sont retrouvées, ont appris à vivre ensemble, ont mêlé leurs gênes et leurs héritages culturels. Et si le style de Djenné est si original, c’est à cause de cette multiplicité confondante d’apports divers parfaitement harmonisés. Le style de Djenné ! Marli Shamir donne à voir des façades d’un dessin splendide, des détail d’architecture d’une finesse éblouissante, des décors typiques, d’inoubliables travaux de second œuvre. Elle nous donne à voir ensuite ces somptueux bâtiments que sont les mosquées de terre crue, qu’il s’agisse de celle de Djenné –dont on pourrait penser qu’elle a tant impressionné Marli Shamir que les images en sont peu nombreuses, de celle de Mopti, ou de celle de San –sur laquelle nous disposons d’un véritable album– sans oublier celle de Gao. En réalité, Marli Shamir a fait de très belles images de la mosquée de Djenné, mais elle sait que ce monument est mieux connu que d’autres, qui traduisent la vitalité actuelle d’une tradition exceptionnellement originale.
Nous entrons ensuite dans les villes, pour les voir s’animer progressivement. Marli Shamir a souvent saisi en seule image les impressions que le voyageur ressent à de multiples occasions : l’étendue des paysages, la paix des ruelles, la chaleur des échanges entre hommes, la discrétion des femmes, le cocasse des installations artisanales… Mais Albakaye Ousmaen Kounta a choisi d’ordonner ces visions. De montrer d’abord des hommes réparant la mosquée de leur village, puis un imam dans la cour de sa mosquée, puis la foule en prière un jour de fête. Ensuite viendront les images sur lesquelles la vie est représentée par des enfants, par des animaux, par des femmes, par les passants dans une rue, par une discussion sur une place de marché, par les instruments de divers métiers (la machine à coudre ou le tam-tam), par les artisans et masques de la fête. Viennent ensuite, regroupées, toutes les images du pays dogon, qu’il s’agisse de paysages, de détails de l’architecture, de scènes de village, de portraits. De même pour les gens des sables et des vents, et pour quelques riverains du fleuve. Ici et là, désormais, Marli Shamir vit au milieu des Maliens, son regard est toujours plein de respect, souvent plein d’admiration, le poète Albakaye Ousmane Kounta l’a senti et nous passe le message.
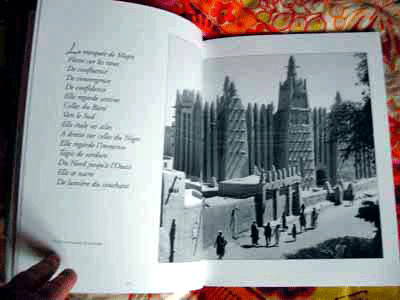
Alors viennent quelques splendides portraits, toujours chargés d’une forte émotion, d’un grand mystère : cet autre que je recherche est là, devant moi, immensément différent –je le lis sur ses traits, je le lis à son regard, je le lis à sa pose plus encore qu’à son costume ou à la couleur de sa peau–, et si proche, l’autre, mon frère, ma sœur, sur cette terre étroite et fragile qui est notre seul bien commun. Et c’est encore une magnifique image qui clôt le recueil, une cérémonie du thé, avec son rite immuable, si lent, si bien accordé à une vie où le temps ne compte pas, une cérémonie à laquelle participent un homme d’âge respectable, très calme, très digne, une femme au sourire éclatant de bonheur avec son jeune enfant dans les bras, et deux autres personnages, dont un enfant, qu’on devine à gauche. Ah, qu’il est bon de vivre ainsi, simplement, paisiblement, dans la joie de la relation !
Suivez-moi jusqu’à Djenné, et au-delà de ses murs parfois aveugles et muets
* Cet ouvrage "ISBN 978-2-909550-52-7, est édité par Les éditions Grandvaux, 18410 Brinon-sur-Sualdre, France, www.editionsgrandvaux.com"
|
|
| |
|
|
|
|
