LE FUTUR DE L’AIDA
Pour
continuer un échange d’idées sur le futur de notre association et pour
inciter ceux qui n’ont pas encore répondu au questionnaire à le faire,
voici quelque éléments présentés par ordre chronologique . Ces échanges
et cette enquête ont été initiés suite au peu de réponses de
participation à l’AG annuelle et son report à l’automne.
MESSAGE DE BRUNO VOITURIEZ
Chers amis,
AIDA: vous connaissez? J'avoue avoir quelques doutes à ce sujet.
En tout cas ne m'en veuillez pas si je ne vous remercie pas de
l'absence de réponses aux questions que je vous ai posées et à l'appel
à remue méninges que je vous avais proposé pour la réunion de l'AG
prévue initialement le 11 avril prochain (cf notre site)......Peut-être
ces messages ont-ils été victimes d'un clic désinvolte qui les a
envoyés à la corbeilles avec la multitude des messages inutiles que,
sans doute, vous recevez.
Prenant acte du fait qu’à ce jour nous n’avons reçu que 10 procurations
et un seul engagement de participation à l’AG, il apparaît nécessaire
de laisser le temps au temps et de nous accorder un délai
supplémentaire de réflexion. La réunion du 11 avril est donc annulée et
reporté à l'automne prochain.
Je vous invite une nouvelle fois à réfléchir à l'avenir
d'AIDA : son utilité, sa forme, ses objectifs, son fonctionnement
etc... A faire connaître votre point de vue en toute liberté par
un échange sur anciens-ird@listes.ird.fr qui est non seulement
souhaitable mais nécessaire pour l’avenir de notre association.
Pour en tirer les conclusions je vous donne rendez vous à
l'automne à Montpellier lors (n'ayons pas peur des grands mots) d'
"Etats Généraux" que je souhaite joyeux et festifs....
D’ici là, riez clair, buvez frais et portez vous bien ! Bruno Voituriez
LA CONTRIBUTION INITIATRICE DE D. CORTADELLAS
Le constat
- AIDA regroupe essentiellement
des "vieux de la vieille", ceux qui ont historiquement partagé un
certain "esprit de corps", de l'ORSOM (des centenaires...) à
l'ORSTOM puis brièvement à l'IRD.
Combien de recrues ayant moins de 5 ans de retraite compte l’AIDA ?
Qui sont-elles ? Quel a été leur parcours ? je gage, un parcours mixte
Institut / Universités où l'individualisme a finalement primé sur le
collectif. Cet individualisme perdure après la "cessation d'activité" :
retraite pénarde que je qualifierais d'égoïste versus retraite "active"
1) associative (hors AIDA) ou entrepreneuriale, et 2) "scientifique" :
publications, formations, vulgarisation, etc.
Aucune de ces formes de retraite n'attend après l’AIDA : les égoïstes
n'ont besoin de personne - les associatifs et les entrepreneurs sont
hors champ, ils ont intégré un autre monde - les scientifiques ont
leurs propres réseaux professionnels.
Restent les ex ORSTOM ou ORSTOM-IRD pour lesquels perdure un certain
esprit de corps et qui désirent garder des contacts et se retrouver
pour des activités communes.
Toutefois ne proposer que des conférences scientifiques (type CIRAD)
est stérile : moi, par exemple, j'ai envie de conférences littéraires
ou artistiques. J'en sais suffisamment en général, à mon orgueilleux
avis et parce que je ne suis plus partie prenante, sur les OGM ou les
cellules souches ou l'évolution climatique, etc. Comme beaucoup d'entre
nous, je suppose, j'espère, je me tiens au courant en lisant des revues
de bonne tenue et en allant sur le web spécialisé, mais je n'ai plus
envie d'entendre l'avis d'un spécialiste forcément partial avec lequel,
n'étant pas spécialiste moi-même, je ne saurai débattre... et sauf si
cette conférence est délivrée par un ténor plein de charisme, ce qui
est rarement le cas, je m'y ennuie !
Répartition géographique : Autre réalité à prendre en compte : dans le
sud, les retraités sont dispersés jusque dans les Cévennes, la Lozère
ou le Minervois... et bientôt les Bouches du Rhône C'est plus
difficile à gérer que la relative concentration de la région
parisienne. Et plus on vieillit moins on se déplace...
Conclusion : Les retraités ont changé de vie. Il y a une vie après
l'IRD... Mais l'erreur est de confondre l'institution et les membres de
l'institution.
Les propositions
Réaliser un état analytique d'AIDA :
sur X membres, de quel âge, de quel sexe, membres depuis combien de
temps (par rapport à l'âge du départ à la retraite), typologie de
carrière (chercheurs, techniciens, administratifs), niveau (Hors
classe, Dr de recherche, chargé de recherche, et idem pour les
techniciens et administratifs), fonctions occupées dans l'association,
etc.
en faire part lors d'une AG sur l'Etat de l'Association.
Réaliser un référendum :
Qu’attendez vous de l’AIDA et définir ce qu’est ou n’est pas l’AIDA
Organiser des rencontres conviviales, festives et culturelles
Y compris des expos et visites scientifiques grand public mais pas (trop) chères.
Exemples : la sortie "truffes" à St Geniès, avec un déjeuner à 60 € par
personne, a fait flop. Au même prix mais cumulant visite et repas, la
sortie à Versailles a bien marché (la clientèle parisienne vs la
montpelliéraine ?). En revanche, la sortie organisée par Roland Poss
dans ses oliveraies, avec dégustation d'huiles, visite du moulin à
huile de Sommières et partage de casse-croûte apportés par les
participants, a regroupé une douzaine de personnes et était fort
sympathique.
Pourquoi ne pas proposer une visite des locaux IRD de Marseille (très
mauvaise idée, mais il faut bien que l'accord AIDA / IRD, une erreur à
mon avis, serve à quelque chose...) ?
Une visite groupée d'un des lieux phares de Marseille 2013, voilà qui est mieux ?
La Villa gallo-romaine de Loupian (avec dégustation d'huîtres à Bouzigues) ?
A la belle saison, un pique-nique à l'Aigoual avec visite du
musée météo, ou une sortie en bateau dans les calanques ? Dali à
Figueras ?
PREMIERE ANALYSE PAR P. ROGER
Nous sommes en 2013. En
considérant que les chercheurs ORSTOM-IRD prennent leur retraite entre
60 et 65 ans cela veut dire que tout chercheur né avant 1948 est
actuellement à la retraite et que parmi les chercheurs nés après 1953
un certains ont déjà pris leur retraite. L'association compte 7 membres nés en 48 ou après et 1 membre né en 1953.
Les résultats ci-dessous montrent que les retraités les plus récents ne
sont pas intéressés par l'AIDA et que l'association est composée
majoritairement par des ORSTOMIENS nés avant 1947, dont un peu plus de
2/3 de DR.
Année Nb
1925 1
1928 2
1930 1
1931 1
1932 2
1933 1
1934 3
1935 1
1936 7
1937 9
1938 8
1939 12
1940 8
1941 4
1942 9
1943 11
1944 7
1945 5
1946 8
1947 6
1948 1
1949 2
1950 1
1952 2
1953 1 |

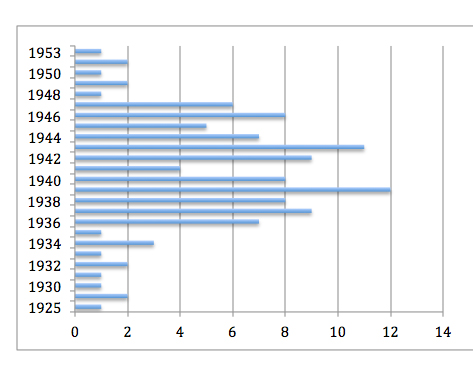
CR 21 19,1%
DR 74 67,3%
IE IR 10 9,1%
autres 5 4,5%
Distribution géographique
Ile de France : 34 Languedoc-Roussillon :
26 PACA : 10 Bretagne : 7
Nouvelle-Calédonie : 7 Autres : 24. Conclusion : 2 zones majeures ( Ile de France et Languedoc-Roussillon)
et trois zones mineures (PACA, Bretagne, NC) pour organiser des
évènements. |
Cette première analyse a été soumise aux membre du Conseil d’administration et à donné lieu aux commentaires suivants.
MARC BIED-CHARRETON
Salut les anciens Orstomiens! si l'on reprend les conclusions statistiques
Rappelons nous nos origines: un petit groupe qui avait envie de
continuer des activités intellectuelles autour de notre maison sur des
sujets en cours mais peu abordés par la direction et la présidence,
avec quelques moteurs dont G.Winter et J.Merle Nous avons ainsi réalisé
quelques analyses, écrites, parfois discutées en comité de direction.
Et ensuite, après quelques années, continuer à travailler n'a pas
attiré grand monde. Pourquoi ?, il faudrait en discuter.
Par exemple, pour mon cas, je m'intéresse toujours au développement et
à l'environnement (séminaires, publications, etc...) mais beaucoup
moins à l'organisation de notre institut dont finalement je me moque un
peu, et je n'y connais plus grand monde. J'étais dans un colloque IRD
fin janvier à Marseille mais nous n'y avons vu qu'un membre de la
direction (L.Vidal) et jamais parlé de cette direction.
Certes nous avons réussi de belles manifestations amicales (la visite
de Besançon par exemple, ou du musée du quai Branly), mais est-ce
suffisant? Voila, bonne journée
Marc
GEORGES COURADE
Je partage l'analyse de Marc et de Pierre: Nous sommes des Orstomiens
avec toutes les connotations que ce terme peut avoir, non des
Irdiens. On subit quelque part la coupure Lazar. Il y a de
nombreuses cultures "maison" et il faudrait que toutes les
cultures soient représentées (professionnelles, géographiques,
disciplinaires, etc.), La question des activités est cruciale. Que
cherche-t-on? Convivialité, mémoire partagée, voyages en commun,
valorisation de nos savoirs, etc. Quels rapports devons-nous entretenir
avec l'IRD-Marseille et son président ...? Comment
utiliser les bases IRD pour nos activités? Surtout, quels
rapports peut-on encore avoir avec les actifs et l'association des
ouvres sociales? Enfin, notre dispersion ne favorise pas vraiment les
activités communes. Désespérant? Un peu. Décourageant? Peut-être
pas. Une enquête sur les attentes de chacun serait utile si on y
répond. Amitiés.
A la suite de cette première analyse une enquête a été lancée avec envoi du texte suivant :
Un message du Président de l'AIDA et un
questionnaire important pour l'avenir de l'association ;
Pourquoi une
association des Anciens de l’ORSTOM/IRD ?
La question pourrait concerner
l’ensemble des associations des anciens de quelque chose.
Si ce n’est qu’il s’agit pour nous d’une association de retraités qui
ne peut prétendre être un lobby cherchant à peser auprès d’une
quelconque institution ou instance politique (au sens large du terme)
comme le sont nombre d’associations d’anciens de quelque chose en
activité. L’idée initiale de faire de notre association un groupe
d’experts mobilisables par l’IRD a fait long feu. Nous sommes donc
libres de toute attache pour mener notre barque en
toute indépendance.
Pour quoi faire ? Là est la question.
Les réponses peuvent être multiples et varient selon les
personnes. La difficulté pour moi est que je ne les connais pas
et suis donc bien incapable d’en faire la synthèse. Synthèse peut-être
impossible d’ailleurs tant les centres d’intérêt et activités
post-IRD des uns et des autres sont divers et ne créent pas
spontanément de « lien social ». Notre unique trait d’union est d’avoir
fait carrière à l’ORSTOM/IRD. L’objectif de notre association doit être
de valoriser ce lien. Comment ? C’est pour le savoir
que je vous avais lancé en février un appel pour que vous vous
exprimiez dans la perspective d’une prochaine AG. L’absence totale de
réponses m’a rendu perplexe et traduit, me semble-t-il, soit un
désintérêt complet des membres pour l’association soit un
décalage entre leurs attentes et les objectifs que
l’association s’est donnés.
Nous étions convenus lors des précédentes AG d’orienter nos activités
selon trois axes inscrits dans les nouveaux statuts : « soutien
pédagogique et faire savoir », « mémoire et valorisation des
expériences », « activités conviviales ». En conclusion de
l’AG de mars 2012 j’avais pris acte de la nécessaire évolution de nos
ambitions : « Passage de l’utopie au réalisme. A savoir: pour la
pédagogie et le faire savoir, faire de l’Association un carrefour des
offres et des demandes plutôt qu’une agence opérationnelle de diffusion
des savoirs, et pour la mémoire passer de l’épistémologie et l’histoire
au recueil de témoignages et de commentaires que chacun d’entre nous
tire de son expérience. »
Quel bilan peut-on faire de l’année qui a suivi ?
L’Association, via son site, a pleinement joué son rôle de carrefour
d’informations sur les activités, les
publications des uns et des autres et les annonces d’évènements
auxquels ils participent. Une visite au site permet de s’en rendre
compte. Et nombre d’entre nous sans doute oublient-ils de transmettre
ce genre d’informations.
Côté mémoire : une contribution de Jacques Claude «
L’Hydrologie de surface de l’ORDTOM/IRD , une science de
l’ingénieur devenue science de l’environnement » et une
annonce de Roger FAUCK concernant la tentative de
publication par sa famille du récit du voyage de B.
LEPOUTRE d’Alger au Congo en 1950 et la recherche de témoignages à ce
sujet.
Au chapitre des activités conviviales l’exposition Maya de la
Pinacothèque et la visite du Château de Versailles ont intéressé
un nombre assez restreint d’entre nous. L’idée lancée l’an
dernier de profiter des conférences mensuelles de l’IRD/Montpellier
pour se retrouver a fait long feu ce qui semble indiquer que ce
n’est pas un retour à la science irdienne qui peut motiver les
membres de l’association. Rappelons aussi, en février 2012 le
forum impromptu, désordonné et sans conclusion : "LES
MAYAS, l’ENERGIE, LES THONS, LA RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,
L’ORSTOM, L'IRD et bien d'autres choses....Type de forum que l’on
pourrait peut-être reprendre de manière thématique avec conclusions
publiées sur le site. A mentionner enfin la coopération avec l’ADAC
(CIRAD) : participation des membres du CA réunis en janvier à une
conférence sur les OGM et une visite « au cœur du village des potiers »
Personnellement je pense que pour vivre une association comme la nôtre
doit créer des occasions de rencontre mais aussi produire quelque chose
et, en l’occurrence ce que l’on appelle des « mémoires d’anciens » ou
des chroniques variées qui pourraient éventuellement être mises en
ligne dans une partie du site ouverte à l’extérieur et déboucher sur
des travaux historiques. Être le client exclusif de sa propre
production est un peu narcissique.
La question posée maintenant est de savoir si l’AIDA
peut vivre sans la participation de ses membres. Evidemment non
et le questionnaire qui vous est soumis ci-joint et les explications et
commentaires attendus sont en fait le développement de la question de
confiance : voulez vous être membre actif de l’AIDA et quelle
contribution êtes vous prêts à y apporter ? Ne vous contentez pas de
remplir ce tableau n’hésitez pas à expliquer et
commenter vos réponses. Un trop faible nombre de réponses
poserait la question du devenir de notre association.
Merci de votre concours.
Bruno Voituriez
ENQUETE :Qu’attendez vous de l’AIDA ?
Indiquez votre intérêt pour les activités proposées par un note de O (pas du tout intéressé) à 3 (très intéressé)
N’hésitez pas à faire des propositions pour des activités non listées ci-dessous
LES RESULTATS
La liste web comporte 127 noms. Fin mai nous n’avons reçu que 23
questionnaires remplis et deux réponses sous forme de commentaires.
L’analyse de ces questionnaires est présentée ci-après.




 Conclusions : (rédigées avant les réponse de Claude et Lhoste,
les valeurs moyennes indiquées sont donc légèrement différentes de celles indiquées ci-dessous, mais les
conclusions restent les mêmes).
Conclusions : (rédigées avant les réponse de Claude et Lhoste,
les valeurs moyennes indiquées sont donc légèrement différentes de celles indiquées ci-dessous, mais les
conclusions restent les mêmes).
1. Faible pourcentage de réponses au questionnaire
2. Les activités qui recueillent un score moyen
supérieur à 2 sont celles qui concernent l’information (moyenne 2,38)
et l’organisation d’une grande réunion annuelle (2,05) (score dominant
: 3)
3. Les autres activités conviviales ont des scores compris entre 1,70 et 2,0.
4. Avec les activités de mémoire on constate un
intérêt plus marqué pour la collecte de textes d’anciens ( 1,76) que
pour des forums de discussion (1,48). (score dominant : 2 et 1)
5. Le score le plus faible est celui des relations
avec l’IRD (1,65 ; score dominant : 1). L’intérêt pour des relations
avec les anciens du CIRAD est plus marqué (1,74 ; score dominant
: 2).
6. L’évaluation du fonctionnement de l’AIDA
(1,65 ; score dominant : 2) montre qu’il y a peut-être des possibilités
d’amélioration !
Les commentaires portés sur les questionnaires ou envoyés par E-mail
1. Commentaires généraux
Alexandre
Très content de recevoir des nouvelles des uns et des autres... parfois
les avis de décès . Pour les petites fêtes et trucs dans ce genre la
Bretagne est bien trop loin de Paris Montpellier ... Amitiés et
bravo pour le travail d'animation
Antheaume
Très honnêtement, je n’ai pas d’attente démesurée de la part de l’AIDA
et donc guère de propositions à formuler. L’AIDA comme son acronyme le
suggère peut certes emboucher les trompettes de la renommée, mais,
comme la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce
qu’elle a… sa bonne volonté, le dévouement de ses membres les plus
engagés, etc. C’est déjà pas mal et tout cela reste fort appréciable
! Pour ma part, je garde le contact avec ma discipline (comité de
lecture de revues, direction de collection, rédaction de papiers,
participation au comité de pilotage du FIG de Saint-Dié des Vosges,
etc. Je reste aussi intéressé par l’évolution que connaît l’IRD dans le
contexte politique et économique actuel, et par son positionnement par
rapport aux Universités et autres grands organismes de recherche, mais
tout cela ne passe pas forcément par l’AIDA et je suis devenu
partiellement hors-jeu. Mon point de vue est devenu celui du
spectateur, pas celui de l’acteur, et je n’ai plus ni le goût ni
l’envie de re-descendre sur le terrain. Le banc de touche me satisfait.
D’autant plus que j’ai très peu de temps disponible, contrairement à la
légende qui voudrait que les retraités soient devenus inactifs. Au sens
INSEE du terme, certes ils le sont, mais pas au sens littéral…
Je suis en fait déjà trop sollicité, mais les journées ne comptant
toujours que 24 heures, je ne peux en faire plus… D’autant plus qu’il y
a aussi une vie après l’IRD, mais qu’elle risque d’être plus courte que
celle d’avant. Sachons en profiter. Hauts les cœurs et
Cordialités à tous…
Carnevale (par mail)
Bonjour et tout d'abord toutes mes félicitations pour votre implication
aussi importante dans cette association des anciens....j'ai noté que
"notre" implication n'était pas aussi intense qu'il l'aurait fallu ...
Mais certaines questions méritent/mériteraient d'être posées...en
commençant par...sommes nous des anciens de l'IRD ou des anciens de
l'ORSTOM....??? et pour ma part je t'avoue que je me considère comme un
Orstomien et non comme un ancien de l'IRD......
Autres temps
Encore bravo pour le boulot et bien cordialement.
Claude
ORGANISATION D’UNE GRANDE REUNION ANNUELLE : de préférence en
septembre ou octobre. Montpellier est certes fort attirant mais il y
aura plus de public en région parisienne, il faudrait donc alterner
Montpellier et Bondy
ACTIVITES DE MEMOIRE.
- et quid du comité d’histoire de l’IRD ? avec le départ de Marie
Noëlle Favier il sera probablement enterré définitivement.
- Forums de discussions thématiques … organisés ou spontanés
- la lettre de Bruno est assez claire sur le devenir possible de l’AIDA
: on n’est plus du tout dans le contexte initial du « comité des
anciens » .... On est dans
le contexte d’une association « des anciens de », mais si c’est
uniquement pour se retrouver à ressasser des souvenirs « les yeux dans
la bière » ça ne vaut pas le coup. Il faut d’une part utiliser les
capacités des membres de l’association dans les 3 directions proposées
par Bruno hors d’un cadre institutionnel et d’autre part susciter et
stimuler l’intérêt des membres pour maintenir chez eux une activité
scientifique que la retraite ne devrait pas éteindre. Pour cela, comme
déjà dit plus haut, il faut recruter de nouvelles énergies dans le
bureau et le CA et multiplier les échanges sur le web et les infos sur
tout type d’activités (même si elles ne sont pas initiées par des
anciens).
- La question de la cotisation reste ambigüe. Est on membre de l’asso
seulement si on est à jour de cotisation ou l’inscription sur la liste
de diffusion et le remplissage de la fiche individuelle de l’annuaire
sont ils suffisants ? Certains trouvent qu’une cotisation à 20 € est
chère pour le bénéfice que l’on peut en attendre et que se retrouver
dans des restos pour des repas à 30-40 € revient cher pour un couple.
Je n’ai pas d’idée géniale pour ces réunions, mais pourrait on
envisager un statut de membre actif (avec une cotis à 10 Euros) et un
statut de membre sympathisant sans cotisation (uniquement échanges et
infos sur le web pour ceux qui ne sont ni à Paris ni à Montpellier) ?
Cornet :
Le Site web est un excellent instrument pour permettre de remplir la
première mission de l’association c’est-à-dire l’échange
d’informations sur les coordonnées des membres, leurs activités,
leurs productions éventuelles, les évènements qu’ils organisent et
auxquels ils participent.
Pour le fonctionnement de l’association, si les trois axes définis
restent pertinents en termes d’affichage, il faut être
pragmatique en matière de contenu. En effet, si la plupart des membres
est intéressée par l’échange d’information, la motivation de chacun
pour des activités est beaucoup plus variable. S’il est souhaitable que
l’association débouche sur des productions, il est difficile que
celle-ci en soit à l’initiative. Celle-ci doit plutôt être
suscitée par une personne ou un petit groupe motivé auquel
l’association apporte son concours.
Pour les activités conviviales elles sont à mon avis importantes.
Cependant compte tenu de la dispersion des membres elles doivent être
diverses, ne pas avoir l’ambition de réunir tout le monde faire,
l’objet d’une information large et de brefs comptes-rendus sur le site
de l’association. Pour les organiser, des petits groupes (sur Paris et
sur Montpellier) pourraient jouer un rôle d’animateur ?
Concernant les relations avec l’ADAC il serait souhaitable d’avoir plus
d’informations sur les activités que l’on pourrait partager avec eux.
AIDA est conçue comme un outils au services de ses membres, chacun peut
s’en saisir, pour son propre intérêt, mais aussi pour faire
fonctionner l’outils , on doit bien être quelques uns à souhaiter le
faire vivre
Fay :
Une remarque qui s’appuie sur le texte de Bruno, que je trouve très pertinent !
« pour la pédagogie et le faire savoir, faire de l’Association un
carrefour des offres et des demandes plutôt qu’une agence
opérationnelle de diffusion des savoirs, et pour la mémoire passer de
l’épistémologie et l’histoire au recueil de témoignages et de
commentaires que chacun d’entre nous tire de son expérience. »
Ces deux ambitions peuvent se retrouver, se rejoindre, se féconder… produire.
Laissons la pédagogie aux professionnels ! Elle demande méthode et stratégies de long terme…
En revanche, avec une perspective épistémologique, votre
expertise et vos savoirs peuvent constituer une très grande richesse en
interrogeant, en commentant, en corrigeant, en discutant des idées qui
constituent le bruit de fond de nos représentations du monde… Je
pourrais citer rapidement : les enjeux environnementaux, la
biodiversité, les questions de développement, la Nature, les sols et
les terres agricoles, les migrations, climat et météo,…
La liste est aussi longue que vos carrières et la diversité des sciences!
Mais, comment procéder ? avec quelle méthode et quels moyens ?
Il conviendrait d’en discuter…
Tout simplement, chaque jour, chacun d’entre nous entend ou lit une
assertion qui mérite un « recadrage » conceptuel par quelques arguments
choisis.
Ici et maintenant, je ne saurai expliquer mieux cet enjeu culturel qui
sert de socle à nos perceptions, voire à nos comportements. Sans
compter les représentations obsolètes dupliquées à l’infini par de très
nombreuses et très généreuses associations !
Le site internet peut servir de plateforme de départ…
Nos interlocuteurs destinataires ? Les professeurs, les associations, les citoyens en quête de compréhension…
L’objectif de communication opérationnel ??? Difficile à prédire… Il suffira d’une étincelle !
Feller
1. Il suffit d'avoir été président, une fois dans sa vie, d'une
association basée sur le bénévolat pour savoir qu'il ne faut surtout
pas en attendre trop. C'est déjà bien quand elle a des membres qui se
réinscrivent chaque année !! Au moins cela prouve qu'il existe une
attitude solidaire vis-à-vis de l'association. Et, pour le reste, il
faut faire confiance aux bonnes volontés et à l'avenir (avec les futurs
nouveaux adhérents).
2. Mon inscription à l'AIDA est, pour l'essentiel, un acte de
solidarité, car si tous les adhérents de l'AIDA sont comme moi, et je
suis sur qu'ils sont nombreux (plusieurs ont témoigné à ce propos),
c'est vrai qu'il nous reste souvent peu d'énergie à consacrer très
activement à l'Association. Mais être adhérent est un signe qui n'est
pas négligeable et justifie déjà l'existence de l'AIDA.
3. Ce qui m'intéresserait à l'AIDA, c'est de voir fleurir les documents à caractère historique sur l'Orstom/IRD, par exemple :
- (comme la proposition déjà soumise) d'une histoire de l'IRD-Orstom Montpellier en relation avec Agropolis, ou encore
- des biographies de grands anciens,
- des histoires d'implantations majeures,
- un regard historique sur la façon dont certains concepts
scientifiques ont émergé à l'Orstom/IRD sur de nouvelles
questions sociétales et/ou scientifiques
- etc.
Pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des "historiens des
sciences" - ce ne sera donc pas un vrai travail d'histoire plutôt un
travail d'amateur - mais mettre déjà en forme lisible un travail de
type inventaire est une activité incontournable et précieuse pour de
vrais projets ultérieurs de l'histoire institutionnelle et/ou
scientifique de l'Orstom/IRD. (En prenant un autre exemple, on sait
tous l'importance des associations historiques locales dans chaque
village, dont les travaux sont un jour utilisés par des Le Roy Ladurie
et autres).
A ce propos...
4. ... le Comité d'Histoire de l'IRD
Après avoir relancé un certain nombre de fois, documents et projet à
l'appui, la direction de l'IRD sur la mise en place d'une structure
chargée de la coordination d'une histoire de l'IRD, et n'avoir jamais
reçu aucune réponse, j'ai adressé, vers avril 2013, ce projet au
Conseil Scientifique de l'IRD via Hervé de Tricornot. Celui-ci en a
fait état en CS, et il semble qu'une discussion soit en cours à ce
sujet au sein du CS. Tout n'est donc peut-être pas encore perdu.
Voilà donc ma maigre contribution.
Pour terminer :
- OUI le site Web est essentiel. Félicitations à Pierre Roger.
- Et que notre président, bien actif, garde le moral !
Bien amicalement
Christian
Parent :
Du fait que je réside en permanence à La Paz en Bolivie, je reste
certes très intéressé à continuer à recevoir les informations à la fois
de l’AIDA et de l’IRD mais ne puis malheureusement pas contribuer aux
activités conviviales. Je garde toujours beaucoup de contacts avec
l’IRD à partir de sa représentation ici en Bolivie pour laquelle
d’ailleurs j’ai été nommé sur place comme « Médecin de prévention ».
Paycheng
Bonsoir, Bruno Voituriez l'a fort bien dit :
" Les centres d'intérêt et activités post-IRD des uns et des
autres sont divers et ne créent pas spontanément de « lien social
». Notre unique trait d'union est d'avoir fait carrière à l'ORSTOM/IRD".
Pour moi, l'AIDA est un "lieu de mémoire", celui des années passées à
l'ORSTOM/IRD et des amitiés qui y sont nées. Ce qui nous
rapproche : les métiers (de la recherche) que nous y avons exercés et
l'expatriation.
Qu'en attendre : le plaisir de se retrouver de temps en temps. C'est
dans cet esprit que j'ai répondu au questionnaire. Bien cordialement.
Claude Paycheng
PS - Il existe une "amicale" de personnes qui chantaient ensemble à
Dakar. Elles se retrouvent chaque année pendant quelques jours.
Ce sera la 32ème fois cet été ! Ce cas n'est pas unique mais les liens
qui unissent les anciens de notre institut ne sont pas du même ordre.
2. Quelles sont vos propositions pour améliorer le fonctionnement de l’AIDA *
Carnevale : Bulletin trimestriel d’information directement vers les
boites mail avec si nécessaire un renvoi vers le site web pour
complément d’info
Claude :
Le fonctionnement actuel repose sur le dévouement de deux ou trois
personnes et en particulier du « webmaster » . Il faut arriver à
impliquer plus de monde en distribuant des tâches avec des objectifs
précis, mais qui ne soient pas trop envahissantes… plus facile à
dire qu’à faire ! mais il faut être réaliste, si l’un des piliers
actuels de l’association fait défaut, tout s’arrêtera. Il faut susciter
une relève et élargir la participation.
Cortadellas : Trouver un « manager » motivé et disponible pour chacune
des implantations AIDA : d’expérience associative, c’est un job à plein
temps et très énergivore. Eventuellement ça se paye… Ce peut être aussi
un sujet d’étude de sociologie ?
Fay : Reunion annuelle entre Paris (Bondy ?) et Montpellier. Si
possible, l’associer avec des visites « culturelles », ce qui ouvre à
d’autres lieux.
Lardy : Sans doute « régionaliser » …France nord, sud, dom,tom, les AIDA à l’étranger doivent se compter sur les doigts.
Marin : Chacun d’entre-nous a trouvé des activités bénévoles dans leur
microcosme. Est-ce une raison suffisante pour oublier que nous sommes
une grande famille qui a travaillé dans des conditions extraordinaires
avec souvent des moyens réduits ? Je ne le pense pas. Adiopodoumé et le
km 17 ont été pour moi une aventure extraordinaire. Devons nous
l’oublier ? Je ne le pense pas. AIDA permet de nous rencontrer et de
sortir de nos contraintes familiales pesantes. AIDA peut permettre cela
en cherchant des thèmes fédérateurs. Des réunions plus fréquentes sur
les sites de l’IRD comme celui d’Agropolis (Montpellier). Un peu
d’huile dans les rouages. Un peu de charisme !
Parent : Du fait que je réside en permanence à La Paz en Bolivie, je
reste certes très intéressé à continuer à recevoir les informations à
la fois de l’AIDA et de l’IRD mais ne puis malheureusement pas
contribuer aux activités conviviales. Je garde toujours beaucoup de
contacts avec l’IRD à partir de sa représentation ici en Bolivie pour
laquelle d’ailleurs j’ai été nommé sur place comme « Médecin de
prévention ».
Perrois : Je perçois personnellement l’AIDA comme une « amicale »
où il est sympathique d’avoir des nouvelles et de revoir de temps à
autre d’anciens collègues, côtoyés outre-mer ou à la DG ou Bondy, mais
pas vraiment comme un IRD bis avec des activités spécifiques «
d’experts-senior de l’Orstom », nourries trop souvent de souvenirs de
recherches déjà dépassées, partant du principe qu’on ne peut être et
avoir été !
Poncet : Je n’ai pas d’idées car les associations d’anciens ne
m’intéressent pas particulièrement et je ne vois pas grand intérêt dans
celle de l’IRD. Désolée de ces réponses tout à fait négatives. En fait,
il me semble que les activités proposées sont « passives » (visiter,
écouter, etc.).
Porges : Que les anciens préviennent le CA des nouveaux retraités
qu’ils connaissent. Leurs coordonnées seraient les bienvenues, avec
leur accord, bien entendu.
Roger : L’activité de l’AIDA dépend bien évidemment de l’implication de
ses membres. Pour le moment il semble que beaucoup soient des
observateurs bienveillants et non des membres actifs.
L’analyse de l’âge de nos membres montre que la génération IRD n’est
que peu intéressée par l’AIDA. Cela correspond peut-être (1) à la perte
d’une identité organisationnelle telle que nous l’avons connue à
l’ORSTOM et (2) à une évolution sociétale où l’individualisme devient
une caractéristique majeure. La génération ORSTOM qui constitue le «
noyau dur » de l’AIDA va continuer à vieillir et sera sans doute de
moins en moins prête à s’impliquer dans l’organisation d’activités
associatives.
Le fonctionnement de l’AIDA et sa continuité vont bien évidemment
dépendre de l’adhésion de nouveaux membres « actifs » au sens propre du
terme. La stratégie qui me semblerait la plus adéquate serait
d’identifier ces collègues avant leur départ à la retraite pour les
motiver.
Schwartz : -renforcer le volet « rencontres », à travers les types d’activité proposées ci-dessous
Trèche : Surtout, essayer d’avoir un site WEB plus convivial et
correctement tenu à jour, mon isolement géographique (résidence en
Corse) rendant difficile ma participation physique à la plupart des
manifestations (dont je conçois tout a fait l’intérêt pour ceux qui
résident à proximité de Montpellier, Paris ou Marseille).
2. Avez vous de nouvelles activités à proposer*
Cheval : Bulletin trimestriel d’information directement vers les boites
mail avec si nécessaire un renvoi vers le site web pour complément
d’info
Claude : C’est pas bien nouveau : j’aimerais que certaines activités du
comité d’histoire mort né soient reprises hors d’un cadre
institutionnel IRD et sans refaire l’histoire institutionnelle de l
‘Orstom-IRD qui me semble assez bien couverte. A l’occasion d’une
demande pour la publication d’un document web sur le 25ème anniversaire
du Centre de Montpellier, je me suis rendu compte de ce qu’il n’y avait
que très peu d’écrits et que les souvenirs des uns et des autres
pouvaient pas mal diverger. Il serait utile par exemple de rassembler
un florilège des grandes aventures de l’Orstom tant que certains
acteurs sont encore là, par ex. les campagnes de géophysique menées par
Melle Craene, l’épopée du programme Oncho, les grandes campagnes
océano, la vie des stations de recherche comme Lamto ou la Mare
d’Oursi, etc.
Cortadellas : Un challenge sportif ??? Selon les entreprises, rien de mieux pour souder une équipe !
Marin : Un historique sur notre histoire locale. Agropolis ? Sa
création ? Le rôle des premiers directeurs de Centre métropolitains ?
Une dynamique sans cesse continue malgré les changements de cap
parisien
Porges : Que des anciens spécialistes de domaines particuliers se
groupent pour proposer des activités sur des sujets qui les intéressent
: rédaction de documents, organisation de conférences…
Poncet :
Malheureusement non. La seule idée que j’ai est de proposer ce que je
fais déjà : randonner à pied (une fois par an ?) dans des endroits
supposés intéressants (mais pour qui ?), avec éventuellement des
commentaires de terrain. Cela suppose des préalables (âge, capacités
sportives, assurances, etc.). Je peux développer cette idée si
nécessaire, mais je suis sûre que tous les membres randonnent déjà…
Roger : Non, car il me semble que les activités proposées font le tour de ce qu’une association comme la nôtre peut offrir.
Schwartz : Le volet « organisation visites de groupe » pourrait être
renforcé. La visite de Besançon, sous la conduite de Jacques Bonvallot,
reste un moment fort ! A l’instar de ce qui se fait au CNRS, un volet «
voyages à l’étranger » pourrait être également envisagé – pourquoi pas
en partenariat avec l’AOS ?
Tréche : Les activités de mémoire ne devraient pas se limiter à faire
connaitre les écrits personnels des collègues qui n’ont pas rompu avec
l’habitude de publier mais elles pourraient aussi inciter le maximum
d’entre eux à s’exprimer par des contributions courtes (pour faciliter
à la fois leur rédaction et leur lecture) sur des sujets transversaux
aux disciplines, aux pays et aux époques. Ces sujets pourraient faire
l’objet de propositions individuelles et être retenus dès lors qu’un
nombre suffisant d’anciens auraient promis une contribution. En
privilégiant le récit d’expériences ou d’anecdotes au cours
d’affectations ou de missions à l’étranger, ils pourraient témoigner à
travers les époques, de ce qu’ont été les conditions de travail et de
vie des orstomiens et des irdiens.
Vaugelade : Les ouvrages de mémoire des anciens sont toujours
intéressants à connaître. Mais, chacun a pu s’investir dans de
nouvelles activités, communiquer sur ces nouvelles activités via la
liste de diffusion des anciens pourrait être une piste à explorer.
3. Etes vous prêt à vous investir dans une ou plusieurs des activités ? Lesquelles ? *
Balden : Organisation de visites dans ma région. visites de sites
naturels, d’entreprises ou autres dans la région Lorient / Morbihan ou
Bretagne . J’ai quelques contacts qui pourraient déboucher sur des
visites intéressantes pour des petits groupes.
Cheval : Information en milieu éducatif ou suivi d’opérations.
Claude : Oui, je suis prêt à continuer :
- dans les activités conviviales si on trouve assez de monde ne serait
ce que pour de simples repas ou cafés scientifico-littéraires…
- dans l’écriture de quelques souvenirs et anecdotes si un rédacteur en
chef (type Jacques Charmes pour le cinquantenaire) prend en mains la
coordination.
Cornet : Oui en fonction des opportunités
Lardy : Je n’ai déjà pas terminé la liste des anciens de NC, et
j’ai honte…j’ai essayé quelques touches pour trouver des volontaires
mais ça n’accroche pas facilement. J’ai pas mal d’occupations mais ce
n’est pas une excuse …
Marin : Je me suis investi dans des domaines extraordinaires comme le
cheminement du Verdanson dans Montpellier ou la nouvelle urbanisation.
Voilà des sujets à exploiter ! Il y a d’autres sujets comme la
Biodiversité. Tout le monde en parle. Est-ce que n’aurions rien à dire
dans ces domaines ?
J’ai dit que je voulais m’investir dans les sorties culturelles. La
Ville de <Montpellier est prête à nous organiser des sorties
thématiques ciblées avec un repas à la clef dans un bon restaurant.
Mais, il faut avoir des personnes intéressées (5 à 10 personnes). Il
faut trouver des financements. Pas simples dans le contexte actuel.
Montpellier se prête a beaucoup de visites thématiques intéressantes.
Des exemples : le Musée Fabre et ses nouvelles acquisitions. Les hôtels
particuliers de la ville. Le nouvel urbanisme. Jean Nouvel et la
nouvelle Mairie. Le devenir des parcs urbains. L’acqueduc de
Montpellier et son histoire de Saint-Clément à la cille ! Mais, voilà,
qui est intéressé par tels sujets !
Cela peut se faire dans d’autres villes.
Je pense à Strasbourg ou à Colmar. Des villes extraordinaires avec des
points de chute non moins intéressants. Pas loin de la cathédrale ! Sa
visite est extraordinaire. Monter sur les toits pour voir l’hotel de
Rohan mérite le détour.
Voilà des thèmes et je suis prêt à les organiser. Pour un groupe
évidemment ! En collaboration avec des amis de la faille orstomienne
évidemment !
Martiny : aide à l’organisation de réunions à Montpellier et dans les environs.
Merle : Trop vieux, place aux jeunes !
Perrois : Pas vraiment car, tout retraité que je suis depuis 1998, j’ai
depuis lors des activités liées à ma spécialité d’historien des arts
africains - et notamment du Gabon et du Cameroun - qui occupent
l’essentiel de mon temps (recherches documentaires, rédaction
d’ouvrages -quatre titres depuis 2000, un en préparation-, d’articles
et de catalogues, participation à des expositions d’art tribal - France
et ailleurs-, voire encadrement doctoral [Paris 1, Lyon II,
Libreville], etc.).
Tréche : Compte tenu de mon isolement géographique et de mes réserves
sur les évolutions de l’IRD au cours des 6 dernières années, je n’ai
pour le moment pas identifié d’activités auxquelles participer (Sauf
contribuer à l’activité de mémoire proposée ci-dessus si elle
était retenue).
CONCLUSIONS
A rédiger (vos commentaires sont les bienvenus) (à envoyer à anciens@ird.fr)
PROPOSITIONS
Vos propositions sont les bienvenues (à envoyer à anciens@ird.fr)
A vos plumes !!!

LES
MAYAS, l’ENERGIE, LES THONS, LA RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,
L’ORSTOM, L'IRD et bien d'autres choses.... (Forum de discussion
impromptu en 2012)
Introduction par le Président Bruno VOITURIEZ
Chers
amis, En février une question sur l’utilisation possible de l’énergie
solaire au Sahara a finalement débouché de manière inattendue sur un
forum traitant de questions quasi existentielles mais récurrentes,
certains diront lassantes, qui accompagnent l’ORSTOM/IRD depuis sa
création et auxquelles chacun apporte sa propre réponse. A moins que,
menant librement ses recherches, il ne se soucie de ces questions que
comme d’une guigne et n’a donc que faire des réponses. De la recherche
coloniale à la recherche pour le développement en passant par la
recherche en coopération quel parcours avons-nous eu ? Qu’ont été nos
expériences et à travers elles quels jugements portons nous sur les
recherches que nous avons menées et leurs résultats ? Nous avons mis en
ligne sur ce site, par ordre chronologique, toutes les contributions à
cette discussion un peu désordonnée. Je vous invite à y jeter un coup
d’œil.
Je
souhaite en effet que l’on n’en reste pas là et que l’on poursuive ce
genre d’activités, occasion pour chacun d’entre nous de témoigner, de
raconter, de faire marcher sa mémoire avant qu’elle ne défaille pour
constituer un fonds à la disposition des curieux et peut-être des
historiens et, pourquoi pas, initier des publications plus importantes.
Je sais que le sujet est chaud et peut entraîner des discussions vives
(confère l’accueil fait au livre de Winter : "A la recherche du
développement. Un fonctionnaire au service d'une passion»). Mais
qu’importe, la polémique entre gens responsables peut être vivifiante.
Profitons de notre liberté pour nous exprimer sans contraintes, sans
regrets et dans la bonne humeur. Cordialement Bruno VOITURIEZ
Pierre ROGER, le 1 février 2012 Objet : AA-IRD, les Masques de jade Mayas
L'exposition
les Masques de jade Mayas fera son grand retour, à partir du 26 janvier
et jusqu'au 10 juin 2012, dans les salles de la pinacothèque du 28,
Place de la Madeleine. Cette exposition devait initialement être
présentée au cours de la saison dernière dans le cadre de l'année du
Mexique en France, mais avait été subitement annulée pour des raisons
diplomatiques. Cette exposition exceptionnelle présentera une quinzaine
de masques, funéraires et rituels, accompagnés de pièces issues de
trousseaux funéraires de hauts dignitaires mayas. Une centaine
d'oeuvres seront exposées, dont six trousseaux funéraires complets. La
plupart des pièces que vous pourrez admirer quitteront le sol mexicain
pour la première fois.
Laurence
PORGES propose d’organiser cette visite pour les membres de
l’association un des mardis 6, 13, 27 de mars, soit en fin de matinée,
pour que nous puissions déjeuner ensemble, soit en début d'après-midi.
Elle irait réserver les entrées et chacun remboursera ensuite
l'association. Si vous êtes intéressé merci de l’indiquer à Laurence
(<l.porges@orange.fr>)avec vos disponibilités pour ces dates.
Cordialement à tous
Yves GILLON, le 1er Février 2012
Les
masques maya sont envoûtants, mais en dehors des plaisirs que nous
pouvons tirer de ce type de manifestation, ne serait il pas judicieux
de montrer que les vieux que nous sommes ont encore des idées générales
pour l’avenir. Pour ceux qui auraient échappé à cette information, il
suffit de rechercher « centrale solaire » et Sahara sur un moteur de
recherche pour constater les rêves qui en découlent. Même des chez
d’Etat africains, Abdoulaye WADE pour ne pas le nommer, sont séduits.
Que l’ORSTOM puis l’IRD ait raté le coche de l’énergie c’est certain.
La raison est même facilement identifiable, mais laisser de tels
délires se répandre serait funeste. Une expertise collective, ou tout
autre moyen serait bienvenue. Lorsqu’on observe que la terre saharienne
retombe à des milliers de km au nord comme à l’ouest, lorsqu’on connaît
la force érosive des vents, lorsqu’on pense aux populations qui vivent
là, soit l’échec est assuré, soit la transformation de l’énergie
incidente serait telle, que l’électricité produite réduirait d’autant
la température au sol et modifierait le climat, et donc l’énergie
incidente. Enfin et surtout, aller prendre à l’Afrique jusqu’à son
soleil au bénéfice de l’Europe … Tant qu’à vider mon sac, ne restons
pas en chemin. Pourquoi ne pas s’être intéressé à l’énergie (en dehors
de bois de feu) ? Simplement parce que les disciplines existantes ont
déjà du mal à se survivre. La dernière grande vague d’ouverture
disciplinaire date de….bien longtemps. Yves GILLON
Dominique CORTADELLAS, le 2 Février 2012:
Salut.
Je dois dire que, même si j'ai trouvé superbes les masques mayas
exposés à la Pinacothèque et apprécié l'iconographie savamment
incomplète, je partage en grande partie l'avis de Yves GILLON sur le
coche raté de l'énergie - et pas seulement à l'IRD. Encore que le
soleil brille pour tout le monde et que ce n'est pas parce qu'une
partie de son énergie est captée au Sahel pour être transportée en
Europe que le Sahel va manquer de soleil. La question se pose
différemment, en retombées énergétiques et économiques locales : si les
dirigeants africains sont séduits, c'est sans doute qu'ils y ont
réfléchi. Elle se pose aussi en calcul de l'impact de ces grandes
installations de capteurs solaires sur l'effet de serre : quel est leur
albédo ? Elle se pose enfin en terme de sécurité énergétique. On a
beaucoup dit que le gaz ou l'uranium ou le pétrole exploités à
l'étranger étaient des sources d'énergie peu fiables parce que soumises
à la situation géopolitique. C'est aussi le cas des terres rares
précieuses à l'industrie. Et il en est de même de l'énergie solaire qui
serait produite au Sahara pour être "exportée" en Europe où le soleil
ne brille pas assez fort : à tout moment, et Allah seul sait combien la
donne politique de ces régions subsahariennes est fragile, une centrale
solaire peut être réduite à néant, ou les câbles de transfert
sectionnés, ou les personnels pris en otage, etc. Et malheureusement,
dans ces cas-là, la négociation économique, parce ce qu'elle n'est pas
l'enjeu, n'est pas une réponse ... Quant à la dernière pierre du sac
d'Yves GILLON, pourquoi les disciplines existantes à l'IRD ont-elles du
mal à survivre ? Il me semble que ce constat ne s'applique qu'à
certaines d'entre elles, les "environnementales" en particulier. Dans
ce domaine, trois explications possibles : - la plus flatteuse pour
notre ego tiers-mondiste collectif, parce que nous avons réussi à
passer le flambeau à nos partenaires et qu'ils s'occupent maintenant
fort bien de leur propre environnement. Le rôle de l'IRD est terminé. -
la plus négative pour ce même ego, parce que l'environnement, en
particulier dans les pays émergents, est devenu la dernière
préoccupation des peuples et de leurs dirigeants, sauf s'il rapporte de
l'argent. L'IRD a échoué et de toute façon son rôle est terminé. - la
plus "prospective", parce que l'environnement est devenu un enjeu
global, que les thématiques environnementales des pays émergents
intertropicaux peuvent être traitées par des chercheurs spécialisés
dans une thématique scientifique plutôt que dans le paramètre
climatique, et que l'IRD ayant, comme l'a dit Yves GILLON, loupé la
marche énergétique, son rôle est terminé ... Un peu de logique : une
expertise collective, mais sur quelle base d'expertise ? Bien à vous
D.CORTADELLAS
Bruno VOITURIEZ, le 4 Février 2012
Ave,
Joli raccourci de la fin des Mayas à celle de l'IRD! Qui incriminer
dans les deux cas: le naufrage climato/environnemental ou la
désinvolture vis a vis de l'énergie? En interrogeant monsieur GOOGLE
j'ai noté que le projet "DESERTEC" constitué d'un réseau de centrales
thermiques solaires du Maroc à l'Arabie Saoudite alimenterait aussi les
pays africains en électricité et permettrait de fournir de l'eau douce
par dessalement de l'eau de mer. Cela explique sans doute la
manifestation d'intérêt de certains chefs d'état. On ne volerait pas de
soleil aux africains...... Expertise collective propose Yves. Où sont
les experts répond justement Dominique CORTADELLAS ? Certainement pas à
l'IRD (et donc pas chez les anciens) qui justement a fait l'impasse sur
l'énergie. Personnellement j'ai spontanément de l'intérêt pour de tels
projets qu' Yves qualifie de délirants. Avoir des projets comme
celui-là ça rend optimiste et donne de l'espoir pour l'avenir. Cela
change des tristes perspectives de l'austère et ennuyeuse décroissance
et de la marche à petits pas précautionneux. D'autant qu'en
l'occurrence la technologie existe, que sa mise en œuvre ne léserait
personne et qu'elle profiterait à tous. Il y a bien sûr les impacts
possibles et je n'ai aucune idée de celui qu'aurait un tel projet sur
les bilans énergétiques. Et surtout les problèmes politiques: il
faudrait un monde pacifié dont on est très loin. En revanche sur le
dépérissement des disciplines de l'IRD voire de l'IRD lui-même nous ne
manquons pas d'experts....Dit brutalement: y a-t-il encore un avenir
pour l'IRD ? C'est la question que pose Dominique CORTADELLAS. Voilà
une belle expertise à faire ou un forum à ouvrir qui permettrait à
chacun d'éclairer l'avenir sur la base de son expérience personnelle et
d'une analyse critique des évolutions et des résultats scientifiques
(réussites, échecs) de l'Institut ......en réfléchissant une nième fois
aux très fines subtilités de la recherche en coopération pour le
développement et cela en toute liberté et indépendance d'esprit sans
qu'il y ait besoin d'arriver à un consensus et en sortant du carcan de
"notre ego tiers-mondiste collectif" comme dit Dominique CORTADELLAS.
Car cet Ego tiers-mondiste, je ne suis pas sûr qu'il soit partagé par
tous..... Portez vous bien.
Jacques COLOMBANI, le 5 février
J'ai
lu vos messages pessimistes sur l'avenir de l'IRD et sur le fait que
l'on a omis de s'occuper des problèmes d'énergie. En ce qui concerne
l'avenir de l'IRD, je ne serai sûrement pas un bon juge ayant pris ma
retraite à 65 ans en 1997. Gardant un œil sur les activités de
l'Institut, tout ce que je puis dire est que des transformations
profondes sont apparues: est-ce bien, cela pourrait-il être mieux?
Est-ce bien en accord avec l'évolution globale de notre planète? Autant
de questions pour lesquelles j'aimerais avoir des réponses argumentées.
En ce qui concerne l'énergie il faut distinguer entre l'énergie de base
(la production possible) et les problèmes connexes (économie, besoins,
environnement …). Personnellement, en 40 ans d'activité, j'ai dû former
une quarantaine de chercheurs et techniciens en hydrologie (certains
sont devenus ministres, d'autres sont partis dans le privé, une bonne
part sont encore chercheurs). Nous avons aussi légué à l'Afrique un
réseau de mesures hydrométéorologiques dense, qui à ce jour a permis de
constituer une base de données indispensable pour l'utilisation des
ressources hydrauliques qui sont très importantes dans la zone
intertropicale et encore peu exploitées. Or la "houille blanche" est
sans contexte la plus rentable des énergies renouvelables: encore
faut-il évaluer les besoins pour une exploitation rationnelle (et bien
sûr trouver les capitaux nécessaires à la construction de centrales).
J'ai aussi souvenir d'avoir rédigé dans les années 60 un rapport sur
les possibilités d'énergie éolienne en Afrique de l'Ouest, basé sur un
réseau de stations de mesure du vent: la conclusion en était d'ailleurs
que les éoliennes ne seraient vraiment pas rentables au sud du 13°
parallèle, par manque de vent. Dès les années 80 la coopération
française a permis l'installation de deux éoliennes AEROWATT
(fabrication française) dans l'Île de Sao Nicolao au Cap-Vert,
rentables pour trois raisons: un vent moyen annuel de l'ordre de 7 m/s,
une île isolée où l'importation de carburant était difficile (pas de
port), une utilisation in situ de l'électricité pour pomper l'eau des
nappes phréatiques à 200 mètres de profondeur afin d'irriguer des
cultures maraîchères suffisantes pour alimenter la population de cette
île où la pluie est rare. Bref, je pourrais donner d'autres exemples
des actions passées, notamment des études hydrologiques approfondies
sur des bassins versants où devaient être construits des barrages pour
une production hydraulique. Je suis beaucoup plus réservé sur
l'exploitation de l'énergie solaire saharienne pour alimenter l'Europe
ou l'Afrique sub-saharienne: rendement faible des centrales solaires,
coût considérable du transport de l'électricité sur de trop longues
distances, tout cela assorti d'une insécurité croissante. Bien
amicalement J. COLOMBANI
Patrice ROEDERER, le 5 février
Nous
n’avons servi à rien !! Ce n’est pas un scoop depuis 1998; OK, dont
acte. Je signale juste qu’à Tana, les chercheurs ORSTOM enseignaient à
l’université dont des chercheurs travaillaient avec l’ORSTOM! Mais où
sont les neiges d’antan!
Bernard POUYAUD, le 5 février
Bonjour,
Sans vouloir participer à la discussion sur le "voler leur soleil aux
africains", car les projets de ferme solaire ne concerneraient au mieux
que quelques % de la superficie des zones désertiques et que lorsque
l'on connaît le rendement des "meilleures" centrales solaires, y inclus
le photovoltaïque, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'albédo…, je
voudrais simplement rappeler qu'une bonne partie des centrales
hydrauliques africaines ont été dimensionnées par (ou à partir de
mesures hydrométriques) des hydrologues de l’ORSTOM, lorsqu'ils étaient
encore des ingénieurs… Dans ce domaine, il reste certes encore beaucoup
à faire. Un exemple le projet "GRAND INGA" sur le fleuve Congo (qui
existe déjà dans les cartons) qui pourrait à lui seul produire presque
de quoi alimenter une bonne partie de l'Afrique… À condition de pouvoir
exporter et vendre cette production jusqu'au Cap et/ou jusqu'au Caire.
Ce projet fut jusqu'ici écarté, non pour des problèmes technologiques,
ni pour des insuffisances de financements, mais parce que la situation
politique à moyen et long terme des pays traversée ne permettait pas de
protéger durablement les lignes à haute tension… On ne peut pas dire
que la situation se soit franchement améliorée ! Et il est probable que
l'ACMI et autres rébellions des confins désertiques ne réservent
durablement le soleil africain à ceux qui y vivent… L'exportation du
Dakar en Amérique latine en est une démonstration, de même que la
répartition actuelle des forces de l'IRD sur la planète… Au moins la
civilisation Maya avait-elle déjà disparu avant que Cortez ne brûlât
ses vaisseaux !!! Cordialement PS : permettez-moi encore de rappeler un
souvenir : en 1984, à Brazzaville, à la conférence du CIEH (Comité
Interafricain d'Etudes Hydrauliques) où l'on se préoccupait déjà
d'énergie, le délégué de Ouagadougou parla très sérieusement d'effet
"photo-burkinabé"… Belle volte-face de l'histoire, n'est-ce pas !
Dominique CORTADELLAS le 5 février
J'adore ces discussions où on parle pour finalement ne rien dire, ou
redire autrement ce que le précédent vient de dire, ou rappeler une
gloire passée et qui hélas a peu produit ... CQFD. Et je le dis
d'autant plus aisément que je fais partie, comme vous tous, de cette
histoire "pleine de bruit et de fureur" et surtout si pleine
d'occasions manquées et de projets non aboutis faute de vision
prospective, faute de réalisme, faute de volonté politique, faute d'y
avoir mis les moyens, faute de confiance dans ses propres ressources
humaines et dans celles de nos partenaires locaux.
Il
faut bien reconnaître que les rares projets ORSTOM/IRD qui aux cours
des âges ont produit des résultats tangibles sont ceux qui ont été
menés en partenariat avec des institutions pragmatiques et spécialisées
comme IFREMER, CNEXO, CNRS, MNHN, CIRAD, INRA, HESS ou autres, dès lors
que nos équipes se sont fondues dans ces structures et ont échappé à la
programmation de leur organisme d'origine. Et c'est bien de cette façon
que, la dernière réforme aidant, l'IRD disparait lentement, comme
digéré ... ses éléments les plus "modernes" scientifiquement parlant
s'étant trouvé, au moyen des UMR, une "niche" dans les dites
institutions ou dans les Universités. Le plus souvent, la valeur de nos
ingénieurs, que d'aucuns opposent aux chercheurs sensu stricto, à elle
seule n'a produit, comme les dits chercheurs, que de la connaissance.
La dite connaissance est bien évidemment fondamentale, utile et
précieuse à tout développement ultérieur, à condition qu'il y ait
ultérieurement développement, ce qui en général n'a malheureusement pas
été le cas sauf convergence avec un outil spécialisé. Or rares sont à
l'IRD les techniques qui ont réussi à émerger en tant qu'outil
transversal de diagnostic de modes de développement, comme la
télédétection par exemple.
L'ORS(T)OM
a vécu cet âge d'or de la connaissance, de l'exploration des milieux
tropicaux. Il a brillé par ses inventaires dans un monde ouvert et sûr
(dois-je ici faire l'apologie de l'heureux temps des colonies ?), mais
ce n'était pas sa finalité, seulement un mode opératoire : nous avons
pris les moyens pour la fin, et ces inventaires n'ont pas servi à grand
chose, qu'à peupler herbiers et collections, n'en déplaise aux
botanistes et autres entomologistes, océanographes, etc. Je sens que
les représentants de ces disciplines vont me tomber dessus à bras
raccourcis ... Qu'ils considèrent que, ayant participé à ces errements
en tant qu'ethnobotaniste, je fais ici en partie mon autocritique.
Succédant à l'ORSTOM, l'IRD, dans un bel effort de modernité, a pris le
virage de la "biologie moléculaire" et cette discipline - avec ses
ramifications - a détrôné les inventaires, qu'elle a rendu souvent
obsolètes : pendant des siècles, on a classé selon la morphologie, et
puis les nouvelles techniques d'analyses (génétiques, chimiques,
spectrales, etc.) ont tout remis en cause ... L'écologie à la mode
redonnera-t-elle des couleurs aux inventaires ? Probablement. Mais
Economie oblige, seuls seront conduits les inventaires qui seront
nécessités par un projet particulier et qui seront financés par les
bénéficiaires du projet (c'est déjà depuis longtemps le cas des
inventaires pharmaceutiques - je dis bien pharmaceutiques, pas
pharmacologiques). Nos vieux inventaires seront jugés poussiéreux et
considérés comme caduques. A refaire ... Seuls les spécimens princeps
garderont une valeur historique. En avons-nous récolté beaucoup ?
Allez,
je ne veux pas trop casser votre moral. Pourtant, je vais encore
rebondir sur le message de Jacques COLOMBANI. Il a raison pour les
éoliennes du Cap Vert : seules les éoliennes plantées en mer sont
productives, il ne faut pas freiner le vent. Créer des barrages pour
fournir de l'énergie hydraulique - et aussi irriguer - c'est bien :
mais on voit que les pays sous les barrages craignent soit d'être
asséchés soit inondés, et que le partage de l'énergie pose problème.
Cas du Niger, du Bengladesh ... Oui on peut pomper les nappes
phréatiques profondes, mais on peut provoquer des effondrements ou
saliniser la nappe. Cas des îles Loyauté, où malheureusement on n'a pas
trouvé de gaz de schistes, ce qui aurait permis de recharger les nappes
! Oui la rentabilité des fermes solaires est faible et le transfert
difficile. Alors pourquoi tant s'exciter là-dessus ? Quels sont les
vrais enjeux ? Salaam DC
Bruno VOITURIEZ, le 7 Février 2012
Merci
Dominique de bien vouloir contribuer au débat en t'exprimant avec
plaisir "pour ne rien dire" comme tu le dis dans ton long et
intéressant message. Je le transmets évidemment aux anciens en espérant
qu'ils trouveront aussi quelque satisfaction à y participer. Pour
résumer ton propos en le caricaturant à peine : à l'âge d'or colonial
de la recherche scientifique à l'ORSTOM s'oppose le déclin inéluctable
de la recherche à l'IRD asservie à la finalité développement via la
coopération. Je pense que tu as parfaitement raison. Cette finalité
introuvable imposée à la recherche et dont le mode opératoire n'était
pas défini a conduit certains chercheurs et ingénieurs à trouver refuge
dans d'autres structures où ils trouvaient un cadre plus propice à la
recherche. Et ils ont bien fait.
Tu
parles de défaut de vision prospective et là je ne suis pas d'accord:
que de "schémas stratégiques", de "plans à moyen terme", d'audits
divers et variés maintes fois répétés ont tourné autour de cet ovni:
"La Recherche pour le Développement". Même l'AA-IRD s'y est lancée, il
n'y a pas si longtemps, et a essayé de répondre une énième fois à cette
question lancinante : "La recherche pour le développement: c'est
quoi?". Alors qu'à mon avis la seule question qui valait était la
suivante: « Comment conforter la recherche dans les pays en voie de
développement? » ce qui impliquait notamment de s'intéresser aux
formations d'Enseignement Supérieur ce que n'a pas su faire
l'ORSTOM/IRD, en Afrique singulièrement où il s'est complètement
désintéressé des universités....Et aussi de soutenir les laboratoires
ce que l'ORSTOM/IRD n'a découvert que tardivement......
Mais
ne pleurons pas: nous avons eu une très belle vie de recherche. Très
libres et finalement peu encombrés par une finalité toute théorique, à
l'air libre aussi et sur des terrains d'autant plus passionnants qu'ils
étaient peu connus et que la découverte était donc à porter de main.
Nous l'avons tous expérimenté: la recherche scientifique à l'ORSTOM/IRD
sans doute plus qu'ailleurs est un jeu amusant. Non vraiment je ne
regrette rien sauf une chose: m'être laissé entrainer par l'illusion du
pouvoir dans la technocratie scientifique qui est parfaitement
stérile..... Tout cela n'allait évidemment pas sans une hypocrisie
certaine et un cynisme non moins certain dont je vous livre témoignage
dans le document joint écrit il y a déjà plusieurs années pour le Club
des Argonautes et que l'on trouve à l'adresse:
http://www.clubdesargonautes.org/libreparole/elucubrations.php portez
vous bien bv
Ce texte est reproduit ci-dessous
Rubrique Fantaisie, Mémento collectif, Élucubrations, Bruno Voituriez
L’expression « Mémento » me rappelle ma jeunesse très catholique et
j’oscille entre la version des « vivants » avant la Consécration et
celle des « morts » après, quand tout a été consommé. Oscillation qui
concerne notre groupe : où se trouvent les retraités dans la dynamique
de l’océanographie ? ; mais qui concerne aussi la dynamique des océans
elle-même qui, ayant connu son apogée, est peut-être en dépit des
apparences scientifiquement sur le déclin. La mauvaise conscience des
océanographes physiciens de l’ORSTOM. Apparemment les Argonautes
savaient ce qu’ils cherchaient: la Toison d’Or. Débutant en
océanographie au milieu des années soixante que cherchions nous ? Rien
de précis. Ce qui, paradoxalement, n’empêchait pas de trouver, parfois.
Mais à la question vicieuse maintes fois posée sans agressivité et même
amicalement comme une manifestation d’intérêt: « à quoi cela sert-il ?
», la réponse était souvent embarrassée et laborieuse. Car en fait on
ne se souciait guère de finalité : nous explorions pour le simple
plaisir de décrire et découvrir. Certes il ne s’agissait pas de
nouvelles terres mais quelle satisfaction de mettre en évidence un
nouveau courant ou une nouvelle structure ! Il fallait quand même
répondre à l’importun questionneur, qui sans malignité de sa part nous
donnait mauvaise conscience. Il était difficile de lui répondre : cela
ne sert à rien et je m’en fiche.
Aussi,
ORSTOM oblige, avions nous construit un discours sur la pêche et
puisque nos campagnes avec le Coriolis nous emmenaient au large, dans
la région équatoriale loin de notre base calédonienne, seul le thon
pouvait faire l’affaire. Qu’importe si à l’époque la pêche thonière
française était inexistante dans le Pacifique mis à part les quelques
bonitiers tahitiens, alors qu’elle était très active dans l’Atlantique
tropical. C’est encore la recherche halieutique et le thon qui
justifièrent l’attribution du Capricorne à L’ORSTOM dans l’Atlantique
Tropical. Nous pûmes ainsi faire une analyse complète des systèmes
d’enrichissement et de leurs mécanismes physiques (upwellings côtiers,
dômes, divergence équatoriale). Mais quel impact sur la recherche
halieutique ? Aucun. A l’époque. Il ne pouvait d’ailleurs pas y en
avoir car les halieutes, sensés être nos interlocuteurs, ne
connaissaient que la dynamique des populations. Autrement ils ne
s’intéressaient qu’à la structure démographique des espèces exploitées,
âge, taille, poids à partir desquels ils faisaient tourner des modèles
pour essayer d’évaluer l’évolution des stocks comme si les fluctuations
du milieu n’avaient aucune influence. Qui plus est, leur
échantillonnage était biaisé puisque la seule source d’information
provenait des captures aux ports de débarquement donc de la pêche
elle-même. En plus il n’existe pas d’état civil pour les poissons : nul
ne connaît le « recrutement et la mortalité naturelle ». Tout se
passait comme si le facteur essentiel était la mortalité par pêche et,
comble de l’ambiguïté, on reconstituait la structure démographique du
stock uniquement à partir des poissons morts de pêche ! Comme disait
SHEPERD « compter les poissons, c’est aussi simple que compter les
arbres sauf qu’on ne les voit pas et qu’ils se déplacent sans cesse ».
Pas
étonnant sur de telles bases qu’en 1978 un rapport de la FAO fasse le
constat suivant : « Les biologistes des pêches furent particulièrement
malheureux dans les avis scientifiques qu’ils donnèrent…en matière de
prévision des effondrements. L’histoire des pêcheries de sardines de
Californie, de harengs atlantico-scandinaves ou d’anchois du Pérou
compte parmi les pires échecs auxquels la science halieutique ait été
associée….L’analyse de la dynamique démographique des stocks suivant
les méthodes classiques d’évaluation uni-spécifiques n’a pas permis d’y
comprendre grand-chose. ». Manifestement l’halieutique n’était pas un
bon cheval pour l’océanographie physique surtout quand, ORSTOM/IRD
oblige encore, il fallait l’assaisonner d’un couplet sur « le
développement » qui ne nous préoccupait pas davantage que la pêche
thonière. Je me rappelle de mon malaise lorsqu’au début des années 70
fut créé un Ministère de la Recherche en Côte d’Ivoire auquel nous
avons du vendre nos programmes de recherche sous l’ombrelle du
développement de la pêche et de son bénéfice pour son pays. Ce rappel
peut paraître cynique mais notre indifférence aux finalités
artificielles n’altérait pas la foi que nous avions dans ce que nous
faisions : après tout, nos collègues métropolitains se passaient de
justifications économico-politiques. L’épanouissement.
C’est
la dynamique du climat qui va donner toute sa place et sans complexe à
l’océanographie physique à l’ORSTOM. Grâce à la préoccupation
climatique il était maintenant facile de répondre à la question « à
quoi ça sert » d’autant que, non sans quelque condescendance, les
professionnels patentés du climat, météorologues et physiciens de
l’atmosphère, reconnaissaient ce besoin d’océanographie. On pouvait
même sans difficulté se référer aux problèmes des pays en voie de
développement très dépendants des fluctuations climatiques. Adieu
thons, anchois et autres sardines : les physiciens tels les argonautes
savaient maintenant ce qu’ils cherchaient ou du moins pourquoi ils
cherchaient. Rien de tel que de bonnes questions pour stimuler la
recherche. Certes ce n’était pas les océanographes qui avaient posé la
question mais qu’importe. Le début de l’aventure fut incontestablement
l’expérience GATE en 197.. (J. MERLE qui en fut une cheville ouvrière
connaît mieux que moi l’histoire). Puis ce furent la PEMG, la création
en France du PNEDC, les participations aux programmes TOGA et WOCE etc…
Toute
l’océanographie française va être mobilisée et propulsée
internationalement, présente des systèmes d’observation in situ aux
moyens spatiaux en passant par la modélisation. Cette montée en
puissance ne se fera pas sans susciter quelques irritations de la part
des disciplines dites géosciences traditionnellement installées et
dominantes dans l’utilisation des moyens à la mer. D’où la création du
Club des Directeurs d’Organismes qui avait un double objectif : donner
les moyens d’une participation aux programmes internationaux par le
canal d’une programmation pluriannuelle des moyens à la mer, au grand
dam des susdites géosciences, et amorcer l’océanographie opérationnelle
que, compte tenu des moyens à mobiliser et de l’absence de « clients
solvables », aucun organisme ne voulait prendre à sa charge exclusive.
Mission réussie : fin de la recherche océanographique ?
Le
projet MERCATOR traduit concrètement la réussite de près de 30 ans de
recherche océanographique pilotée par le climat. Réussite scientifique
d’abord mais aussi politique puisque les organismes ont réussi à se
mettre d’accord pour se partager le travail. MERCATOR première
expérience en France d’océanographie opérationnelle. Les expériences
internationales en cours ou à venir comme GODAE et ARGO qui visent à
améliorer en mode opérationnel les modèles dynamiques d’océan vont
maintenant mettre en concurrence les différents modèles opérationnels,
tels MERCATOR, développés dans le monde. Fort de ce succès qui
ressemble à une apothéose peut-on prophétiser la fin de la recherche
océanographique comme Fukuyama voyait dans la chute du communisme le
triomphe universel définitif du libéralisme démocratique et donc d’une
certaine manière la « Fin de l’Histoire » ?
Projetons nous de quelques années en avant à l’issue de l’expérience
GODAE : nous disposerons de modèles à haute définition de la
circulation océanique mondiale et de systèmes opérationnels
d’observation in situ et dans l’espace qui permettront des prévisions
qu’utiliseront divers clients : climatologues, écologues, pêcheurs,
navigateurs. L’océan sera en quelque sorte « scientifiquement résolu ».
Comme le disait, il y a quelques années, un éminent Professeur
français, l’océan, fluide monophasique, ne sera plus un problème de
physique. A la question « que faites vous ? » l’océanographe répondra :
« je récolte et traite des données ». Si on lui demande « que cherchez
vous » il répondra : « rien ». Et pour répondre à la question initiale
à laquelle il ne savait pas répondre il y a trente cinq ans : « à quoi
ça sert ? » il pourra sans complexe faire de longs discours sur la
prévision de l’évolution du climat d’El Niño à l’effet de serre sur la
variabilité des stocks de poissons etc…. Au club des Argonautes de
chercher le « bug ».
Dominique CORTADELLAS, le 7 Février
Mais
si, Bruno, tu es d'accord avec moi sur l'absence de prospective aussi,
il n'y a qu'à lire ta page Argonautes pour s'en persuader ! Je suis en
tout cas parfaitement en accord avec ton analyse de la "recherche pour
le développement". A l'époque où, pas encore IRD, nous n'étions plus
qu'un acronyme confié à des mains ... manipulatrices, comme nous avons
été naïfs. Je partage aussi entièrement ta satisfaction de la vie que
nous avons menée, toi sur le dos des thons et moi à la recherche de la
plante miracle. Je ne l'ai pas trouvée mais sa quête m'a permis de
rencontrer des personnes remarquables, dont je me souviens bien mieux
que de la botanique, le côté "ethno" de l'ethnobotanique. De beaux
souvenirs, certes, mais quand même nous aurions pu être plus utiles.
Car finalement, si l'on n'est pas utile, on n'existe pas. Ou plutôt, si
on n'a pas été utile, on n'a pas existé, pas laissé de traces ... DC
Jacques MERLE le 8 Février
Je
ne me sens pas très qualifié pour parler de la spécificité de
l’IRD/ORSTOM dans le monde de la recherche mais je félicite Yves
GILLON, Dominique CORTADELLAS, BV et d’autres, d’avoir ouvert ce forum
et de manifester leurs visions des choses; j’ai plaisir à noter que
c’est la première fois, à ma connaissance, qu’au sein de l’Association
des anciens un tel débat d’idées et d’opinions s’initie spontanément
attestant une certaine vitalité de notre association. D’où ma
participation à ce débat d’idées et l’évocation de quelques points que
j’ai en tête... Pour moi il faut distinguer la recherche, les
applications de la recherche et le développement (implicitement du
Sud). L’ORSTOM/IRD a longtemps oscillé autour de ces trois pôles. La
réforme LAZARD, à laquelle j’ai adhéré, à clairement positionné
l’institut dans le champ de la recherche. LAZARD se plaisait à dire que
: “l’Institut est un organisme de recherche .... pour le développement
(c’est à dire avant tout une recherche qui peut être utile au
développement) et non un organisme de ..... Recherche pour le
développement (c’est à dire une sous-recherche pour les sous-développés
...) ”.
Pour
moi encore l’exploitation des ressources énergétiques, solaires ou
autres, des pays du Sud, n’est pas un domaine de recherche; mais
appartient au mieux et pour partie au domaine des applications de la
recherche et plus explicitement au développement, sous entendu du Sud.
Voila pourquoi les “ chercheurs environnementalistes ” que sont les
océanographes physiciens, géophysiciens, hydrologues ... les plus
proches des concepts de l’énergie, ne se sont pas intéressés à cette
question de l’exploitation de l’énergie car ils se considéraient déjà,
avant LAZARD, comme avant tout des chercheurs à part entière. Ceci dit
ce positionnement des chercheurs ORSTOM/IRD dans le champ de la
recherche, comme n’importe quel CNRS, ne fait plus d’eux des
spécialistes exclusifs et dédiés aux problèmes de l’application de la
recherche et du développement au sud; c’est l’ensemble de la Recherche
française, impliquant l’ensemble de ses EPST, qui est potentiellement
concernés et mobilisée pour aider le Sud à se développer; c’est ce qui
justifie la création de l’Agence, encore au sein de l’IRD, mais germe
d’une agence nationale pluri-organismes destinée à aider le Sud à se
développer par les applications de la Recherche et le renforcement de
sa propre recherche.
Ce
qui signifie à terme la disparition de cet étrange institut de
recherche spécialisé qu’était l’ORSTOM/IRD. A parcourir les couloirs et
les ascenseurs du siège marseillais actuel de l’IRD on comprend vite
que notre cher institut n’existe plus, mais que l’agence fédératrice
qui est sensée lui succéder n’est encore qu’une ébauche bureaucratique
dont on peine à saisir les contours et la réalité. D’où la
préoccupation actuelle de l’Association des anciens de conserver avant
tout une “mémoire” de cet irrévocable passé, en évitant de trop
spéculer sur un, ou des, avenir(s) possibles de l’institution que l’on
a connue, telle qu’on l’avait inscrit initialement dans les statuts de
notre association..... Jacques MERLE.
Yves DANDONNEAU le 8 Février
Bonjour
à tous, Je mets mon grain de sel parce que j'ai beaucoup aimé mon
métier, et parce que l'ORSTOM/IRD m'a laissé à peu près faire ce que je
voulais. La difficulté existentielle de l'IRD a toujours été évidente
pour moi. Je me souviens des visites de CAMUS dans les centres ORSTOM ;
il nous terrorisait (c'était son style), et surtout, il brandissait la
menace d'un désaveu de la part de nos ministère de tutelle. Celui de la
coopération en particulier. J'ai le souvenir que l'utilité de l'ORSTOM
a toujours été mise en question et qu'aucune réforme n'a vraiment
apporté de solution.
Bruno
a raison, ce que nous avons vraiment raté c'est la formation de
chercheurs dans les pays où nous étions présents. Je me souviens lors
d'une visite du ministre de la recherche local avoir vu faire mettre
des blouses blanches à des techniciens qui n'en portaient jamais et les
avoir fait asseoir devant un microscope. Et je me souviens aussi avoir
vu, après mon retour en France, des chercheurs africains, coachés par
des universitaires ou par des chercheurs du CNRS, passer leur thèse.
Nous avons vécu une transition. Au début, il était possible à un
chercheur isolé de faire du travail utile en tirant profit des
originalités du terrain. Maintenant, on ne peut plus faire grand chose
si l’on n'est pas immergé dans de grandes structures de recherche, avec
les échanges d'information que cela permet. Plus besoin d'un corps de
chercheurs ORSTOM ou IRD. D'ailleurs, le recrutement par concours après
une thèse universitaire gomme les différences avec les chercheurs
d'autres organismes. YD
Dominique CORTADELLAS le 8 Février
Merci
à Yves DANDONNEAU et à Jacques MERLE de continuer ce débat spontané que
je pensais devoir s'éteindre. Leur sage recul leur permet de s'exprimer
de façon plus élaborée que moi. Et pourtant, toutes leurs contributions
aboutissent au même constat. Nous avons eu du plaisir à travailler et
nous pensons pourtant avoir rempli de façon incomplète des missions mal
définies. Cette unanimité est troublante. Quant à la formation, un vrai
sujet, je propose d'en étendre la notion à celle de partenariat, toute
une philosophie. DANDONNEAU raconte les blouses blanches et les
microscopes de circonstance confiés pour la montre à des nationaux
incompétents, les mêmes probablement que l'on donne à voir dans
Sciences au Sud - qui, soit dit entre nous, ne cesse de citer les mêmes
résultats à quelques variantes près : sa lecture régulière conforte
l'impression que la recherche pour le développement n'ouvre pas de
nouveaux champs dans quelque domaine que ce soit. La communication est
une arme redoutable.
A l'inverse, je me souviens d'une collaboratrice malgache biochimiste
qui avait brillamment passé sa thèse d'Etat française au sein d'une des
meilleures équipes de Strasbourg, et pour laquelle j'avais obtenu un
stage de spécialisation en pharmaco-chimie. Mais la direction de
l'ORSTOM, c'était dans les années 90, s'obstinait à ne voir en elle
qu'une laborantine incapable de mener la recherche pourtant fort
basique que nous lui proposions "en partenariat". Dans ce contexte, il
fallait la diriger, elle ne devait pas avoir de responsabilité
scientifique dans le programme, ne pas prendre d'initiative de
recherche ... Cette vision passéiste, pour ne pas la qualifier plus
durement, et les positions rétrogrades qu'elle a entraînée ont fini par
avoir la peau du programme. Cordialement DC
Louis MARTIN le 8 Février
Bonjour,
Je trouve assez extraordinaire ce débat. Les Français ont une capacité
incroyable à l'auto flagellation. Le passé, c'est le passé, on ne peut
plus le changer. Cela ne sert à rien de savoir si on n'a pas su prendre
tels ou tels virages importants. Nous avons été chercheurs à une époque
qui n'a rien à voir avec l'actuelle. l'IRD d'aujourd'hui n'est pas
l'ORSTOM de nos débuts. C'est un fait.
Personnellement
j'ai eu "la chance" que l'on me parachute (seul) au Brésil en 1973,
avec un parachute percé. Par contre, j'ai bénéficié d'une grande
liberté. Finalement, j'y ai fait mon trou et y ai passé près de 27 ans.
Je pense y avoir fait de la Recherche, du Partenariat et de la
Coopération (mais pas au sens africain). Je pense y avoir laissé
quelque chose. Je n'en veux pour preuve que le fait que depuis mon
départ à la retraite en 2000 mon nom apparaît dans 15 publications de
rang A et que j'ai été élu membre de l'Académie des Sciences du Brésil.
L'avenir de IRD, s'il en a un, appartient aux chercheurs actuels. Il
est probable qu'ils n'ont rien à faire de nos états âme. Maintenant, ma
préoccupation c'est le golf et j'ai appris à oublier le coup manqué
pour me concentrer sur le coup à venir, pour lequel tout est encore
possible... Amicalement Louis Martin
Jacques COLOMBANI le 9 février
Très
intéressant de suivre les points de vue assez différents sur notre
"utilité" passée et future. J'aimerais bien avoir l'opinion de ceux qui
sont présentement en charge de la Recherche pour le "Développement".
Une remarque concernant le Bangladesh cité par Dominique: au début du
20 ° siècle ce pays comptait environ 15 millions d'habitants, et
maintenant environ 150 millions avec une densité supérieure à 1000
habitants par Km2. Si nous avions la même densité en France nous
serions 556 millions de Français et je pense que nous serions pauvres
pour la plupart, que nous aurions faim, que nous manquerions d'eau et
d'espace.
Nos
démographes ORSTOM ont mené de très intéressantes études démographiques
(voir les cartes disponibles dans la base de données IRD), mais a-t-on
mené des études pour en tirer les conséquences sur les possibilités de
développement, sur l'impact écologique etc… Personnellement j'ai
comparé les taux de CO2 à la population mondiale depuis 1800 jusqu'à
2050 (en utilisant les prévisions ORSTOM, Onusiennes, ou celles du GIEC
pour les années futures). Le coefficient de corrélation est d'environ
0,96 soit presque 1 ! Mais il faudrait faire des études poussées sur
les problèmes que pose cette croissance démographique: le fait-on? Bien
amicalement à tous J. Colombani
P.S.
Actuellement conseiller municipal de ma commune (St Martin de Londres)
j'utilise mes connaissances d'hydrologue et d'hydraulicien pour les
problèmes d'eau potable, d'assainissement, de protection contre les
crues, pour les projets Natura 2000, pour le SCOT et dans le cadre de
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup; mes activités
passées auront au moins servi à cela!
Jacques CLAUDE le 11 Février
Depuis
que je vois passer ces échanges de courriels sur le passé de l’ORSTOM
ou le déclin de notre métier de chercheurs pour le développement, je ne
résiste pas au besoin d’y mettre mon grain de sel … Parmi les nombreux
points de discussion abordés, je n’en retiendrai que trois ou quatre.
L’IRD a raté le coche de l’énergie: oui, bien sûr, mais ce n’est pas
l’IRD qui a failli, c’est la France entière qui s’est laissée endormir
par les puissants lobbies nucléaire et pétrolier; gouvernants,
scientifiques, collectivités, grandes et moyennes entreprises,
consommateurs et citoyens, tous convaincus de ce “qu’en France on a pas
de pétrole mais on a des idées” et que nos centrales nucléaires nous
fournissaient l’électricité la moins chère et la moins polluante ont
longtemps considéré que les autres sources d’énergie, en particulier
les renouvelables, étaient certes intéressantes mais dans très
longtemps, ou pour les autres, ou pour apaiser nos remords
environnementaux; ce qui fait qu’aucune filière innovante, aucune
industrie intégrée n’a pu émerger dans le domaine des énergies.
A
peine réveillés par nos engagements européens, les fameux trois –20% à
atteindre d’ici 2020, nous menons une politique de gribouille faite de
subventions et d’allègement d’impôts sans objectifs à long terme.
Résultat par exemple: au lieu de développer une filière industrielle
dans le photovoltaïque, on a lancé une nuée de commerciaux à l’assaut
des maisons individuelles, de préférence habitées par des retraités,
pour leur vendre à crédit du matériel chinois, allemand ou espagnol,
installé à la va-vite par des techniciens à peine formés qui se
retrouvent au chômage 3 ans après. Le but n’était pas de développer le
solaire mais seulement de siphonner les économies de ces braves
retraités. Dans une économie qui se veut libérale et libre échangiste,
on n’imagine pas d’autres mesures que des subventions et des
allègements d’impôts, ce qui fait qu’un chauffe eau solaire coûte 3 à
5000 € et un chauffe eau électrique 3 à 500 €, cherchez l’erreur! S’il
y a un domaine où l’on pourrait suivre le modèle allemand c’est bien
celui là.
Bref,
tout ça pour dire que l’IRD ne s’est pas distingué des autres
organismes de recherche français dans ce domaine et qu’il n’y avait pas
de chercheurs susceptibles de réorienter leurs thématiques de recherche
pour se pencher sur les énergies renouvelables dans les pays du Sud,
alors que le GRET multipliait les expérimentations technologiques (un
seul essai à ma connaissance a été fait par J.P. MINVIELLE qui a
participé à un groupe de travail européen sur le Sahel). Les grands
projets délirants: il n’en a jamais manqué depuis la Tour de Babel ou
les Pyramides d’Egypte jusqu’au Canal de Suez et de Panama.
Je
suis d’accord avec Bruno, il faut laisser une part de rêve et
quelquefois “the dream comes true”. Qui aurait rêvé il y a 20 ans
d’avoir dans sa poche un GPS qui le guide au sol au mètre près grâce à
une ronde de 30 ou 560 satellites à 800 km d’altitude ? Certes il faut
rester réaliste et surtout éviter d’embarquer dans ces délires des
dirigeants politiques toujours tentés d’attacher leur nom à un projet
pharaonique. Mais je pense qu’il y a encore de la place pour quelques
belles réalisations, en particulier en matière d’énergie: les éoliennes
en mer bien sûr (mais ça n’est plus du rêve, c’est moins cher que des
plate formes pétrolières en haute mer), mais aussi quelques grands
barrages comme celui d’Inga sur le Congo, et pourquoi pas une
gigantesque usine marée motrice dans le détroit de Gibraltar. Le gros
problème (souvent insurmontable) de ces grands équipements n’est pas la
technologie qui existe ni même les financements énormes à mobiliser,
c’est la volonté politique des nombreux pays impliqués dans ces projets
et là, je pense que la science est dépassée!
Le déclin de nos disciplines ou de nos profils de chercheurs pour le
développement: Bientôt 70 ans que la question est posée puisqu’elle est
consubstantielle à un institut créé pour cela et soumis de plus à deux
tutelles, et pour ma part 40 ans que je la tourne et retourne (combien
de pots et de bouteilles n’avons nous pas vidés au cours de discussions
passionnées !). Mais cela ne m’a jamais empêché d’agir ni posé de
problème existentiel. Je crois que ce qui nous a tous motivés dans nos
métiers respectifs c’est la passion pour ce que nous faisions et le
plaisir de découvrir des “nouveautés” dans une certaine liberté, mais
chacun a son vécu et perçoit “l’utilité de son oeuvre” selon des
critères qui pour beaucoup échappent au contexte institutionnel ou à
l’évolution des politiques scientifiques.
Je
ne prétends pas avoir fait de la recherche de pointe et avoir permis
des avancées remarquables en hydrologie, mais je pense que j’ai eu la
chance de participer à des aventures d’équipes qui auront
significativement fait progresser les connaissances. Et quand je vois
l’utilisation qui a pu être faite de nos médiocres rapports ronéotypés,
par exemple dans le schéma directeur des eaux du Nord de la Tunisie, je
me dis que ça valait le coup de passer quelques nuits sur le terrain à
tremper le moulinet et quelques week-ends à faire tourner le gros
ordinateur des chèques postaux auquel nous avions accès.
Avec
le recul, je pense que les actions les plus efficaces pour le
développement sont les actions de formation, à tous les niveaux. Et là,
je reconnais que l’ORSTOM n’a pas toujours été un modèle et qu’en
dehors de la filière “élèves ORSTOM” il n’y avait pas beaucoup de
possibilités d’accueil de chercheurs et étudiants étrangers. Mais
depuis les années 90, cette lacune a été bien comblée et, là aussi, il
y a tout lieu d’être fier en voyant 10 ou 15 ans après nos ancien(ne)s
stagiaires et thésard(e)s prendre la tête de leurs équipes de recherche
dans leur instituts nationaux. Déjà plus d’une heure que je déblatère,
je m’arrête, mais reste prêt à poursuivre cette passionnante
discussion. Bien à vous tous.
René de MAXIMY le 13 Février
Je
m'étonne que tous ces anciens aient mis si longtemps à se rendre compte
de la distance existant entre leurs recherches et les applications
possibles. Lorsque, invité par Pélissier et Sauter à rejoindre
l'ORSTOM, je suis arrivé sans passer de concours, dans notre Institut
encore qualifié d'Office (1982) c'était justement pour essayer
d'établir un pont très fréquentable entre recherche et application dans
le domaine des sciences sociales s'intéressant à l'urbain. Sauter et
Pélissier étaient convaincus qu'il était temps de faire se rencontrer
sérieusement chercheurs et praticiens de la Coopération pour le
Développement. J'étais, à leurs yeux, un cas rare installé sur ces deux
dimensions de la géographie dite appliquée et pour cela susceptible de
favoriser une recherche-action qui vaille le coup. L'incompréhension de
l'ORSTOM fut alors incommensurable et le procès qui me fut fait
prétendait qu'ayant servi pour le privé (qui, en fait de "privé", était
alors les Ministères de l'Équipement et celui de la Coopération !…).
J'étais à la solde du Capital, ce qui était bien mal me connaître et
risible. J'ai donc décidé de n'en faire qu'à mes propres décisions.
J'ai, pour ce faire, lancé un programme de recherche, répondant à mes
objectifs d'application de la recherche, sur Quito. Avec une équipe
franco-équatorienne agissant sous ma responsabilité scientifique et
très active, s'appuyant surtout sur Henry GODARD et Marc SOURIS, l'un
et l'autre chevilles ouvrières indispensables, mais aussi d'autres
chercheurs équatoriens et français, j'ai mené cela à bien et avec
succès en des temps que j'avais précisés au début de cette recherche et
avec un observatoire urbain informatisé et viable à la clef. Par
incapacité à se réformer mes collègues orstomiens puis irdiens n'ont
pas été capables de transformer sérieusement l'essai et de poursuivre
dans ce sens, c'est-à-dire dire faire de la recherche ailleurs de la
même façon et dans la même esprit. Au point que, le responsable du
Programme des Nations Unies pour l'Habitat au Kenya ayant demandé à la
représentante d'alors de l'IRD à Nairobi de me contacter pour prendre
en main un grand programme pluridisciplinaire portant sur l'étude de
plusieurs grandes villes d'Afrique et sur les applications possibles
qu'on en pourrait faire, cette demande ne m'est jamais parvenue et je
n'en ai entendu parler qu'incidemment, des années après et bien trop
tard, par le demandeur du PNUH lui-même.
Alors
maintenant, les "vieux" viennent nous ressortir l'idée d'une
coopération entre chercheurs, "scientifiques" cela va de soi, et
planificateurs-acteurs !!!! Cela me fait sourire d'un sourire plein
d'ironie… Il y a trente ans que je suis arrivé à l'ORSTOM avec un tel
projet dans mes bagages. Or, le corps des chercheurs et le staff des
administratifs chargés d'aider à fonctionner notre institut, en ce
temps-là encore office, n'ont eu de cesse, alors que de poursuivre
leurs ronronnements sécuritaires. Car le confort des chercheurs fut le
produit de leur statut de fonctionnaires, le drame de nos recherches
fut celui de n'avoir pas à se battre pour faire passer nos idées dans
la recherche appliquée, alias recherche-action, et de rester installés
dans nos convictions de chercheurs sans compromis parce que sans
applications.
Alors
j'ai roulé selon mes idées et convictions, grâce à l'assistance
inconsciente et l'incompréhension bien installée de notre Institut.
J'avoue que j'ai eu beaucoup de liberté d'action, non pas parce que
j'ai eu des crédits, mais parce que le fait d'avoir un doctorat d'État
et d'avoir eu une médaille de bronze du CNRS en 1984 me mettait en la
situation confortable de quelqu'un qui ne se sentait pas dépendant
d'évaluation autre que celle de mes pairs en la matière, c'est-à-dire
des professeurs d'université très indépendants de la structure
irdienne. Voilà ce que j'avais à dire maintenant que je m'adonne à mon
autre passion qui est très littéraire : romans, nouvelles, poèmes…
Cependant
je me réjouis de trouver tant de désir d'application parmi mes chers
collègues et néanmoins amis pensionnés du gouvernement et inscrits au
Grand Livre de la Dette Publique, selon la formule. Aussi, je suggère
de créer entre vétérans une structure d'experts qui pourraient se
lancer dans des expertises complétées par des suggestions et
propositions d'application, en les domaines qui sont les nôtres. Cette
structure pourrait être attractive pour des bailleurs de fonds car,
déjà assurés de revenus fixes et mérités par notre labeur passé, nous
ne coûterions que des honoraires raisonnables et des frais de
fonctionnement inhérents à l'exécution des contrats obtenus. J'ajoute
que le cas échéant je ne prendrai pas en charge cette responsabilité
car je suis bordélique, ce que tous mes amis, et même mes ennemis, si
j'en ai, ce que je ne sais pas, savent… Mais j'accepterai d'y apporter
mon concours éventuel.
Et
d'abord je propose un objet d'études complétées éventuellement par la
formulation d'applications. Voici : Reprendre l'étude du Lagon de
Mayotte, dont les auteurs furent entre autres : GUILCHER (décédé),
DOUMENGE (décédé), BATTISTINI (toujours en vie à ma connaissance).
Cette étude a été publiée par l'ORSTOM dans les années 60 ou 70.
Ensuite retourner sur place pour approfondir les caractéristiques et
les capacités d'accueil du site, au sud de cette île et dans la partie
sud de son lagon, formé par une sorte de sous-lagon à l'intérieur du
grand lagon. Car l'enfoncement de l'île, ou la montée des eaux de
l'Indien, ont ennoyé une vallée de cette île, ce qui a permis qu'une
barre corallienne ait pu s'élever pour fermer ce micro-lagon.* Il
suffirait donc de l'isoler par des filets à requins et autres
prédateurs, de favoriser la prolifération d'espèces halieutiques
intéressantes, d'en assurer un vrai développement par des mesures
biologiquement acceptables et probablement un enrichissement
nutritionnel de ses eaux afin d'avoir un piège à poissons exploitable.
Si cela tient la route, élargir en un deuxième temps cette réalisation
à l'ensemble du lagon (seulement trois grandes passes à fermer aux
grands prédateurs) et, expérience réussie, en tirer parti pour
l'aménagement d'autres lagons dans le monde. Une telle recherche-action
demande la collaboration de géographes, océanographes, probablement
géologues ou vulcanologues, sociologues, ingénieurs des TP,
nutritionnistes, biologistes (ichtyologues) etc. J'ai aussi quelques
idées pour des élevages de tilapias dans les eaux réchauffées mais non
radioactives d'étangs accueillant les eaux de refroidissement de nos
centrales nucléaires en attendant les sources exploitées des énergies
renouvelables et le démantèlement des dites centrales nucléaires. Ces
étangs pourraient être complétés par des papyrus, des roseaux et
bambous, quelques crocos et des hippos, une lodge etc… des margouillats
mâles multicolores et leurs femelles en grand deuil, entre autres
gadgets… Imaginez-ça sur les bords du Rhin à Fessenheim ! Si tout ça
vous paraît farfelu, n'en parlons plus. Si vous cherchez d'autres idées
je reste à votre disposition. Bien amicalement à tous. René de Maximy •
Voir mon bouquin sur l' " Étude géographique de l'archipel des
Comores." Ce travail est introuvable, excepté dans quelques
bibliothèques universitaires et un exemplaire à l'IRD, à qui je l'ai
vendu.
Francois JARRIGE le 15 février
Bonjour
à tous, Permettez-moi d'amener ma petite pierre à l'édifice de notre
mélancolie ... Les deux derniers messages de Jacques CLAUDE et de
Jacques MERLE sont, à mon point de vue, assez réalistes : le débat a
mûri. Pour ce qui est du ratage du coche énergie, je rappellerais qu'en
1983, nous avions un département intitulé "Indépendance énergétique"
sous la responsabilité de Jean-Marie WACKERMANN. Malheureusement il
n'était pas question de créer des programmes dans des domaines où nous
n'avions pas de chercheurs compétents et il nous fallait une autorité
(personnalités extérieures) pour valider nos orientations. Donc
problèmes de compétence et de légitimité.
Les
domaines où nous pouvions prétendre avoir des compétences, étaient bien
sur l'hydrologie, la pédologie, la géologie et d'autres. Au sein de
l'ORSTOM, l'hydrologie passait pour faire du développement et
fonctionner comme un bureau d'étude, et le CT était "contrôlé" par EDF.
La Pédologie, dans une moindre mesure, était limitée dans ses
orientations d'applications par le CIRAD et l'INRA. Enfin la Géologie
avait en face le BRGM qui nous interdisait des chantiers. Le
département F s'est alors orienté vers les biotechnologies avec un
certain succès. En 1987, de nouvelles orientations sont données et la
question n'est plus à l'ordre du jour ... Recherche et ... de ...
pour.. le développement.
De
ma dernière affectation à Madagascar, j'ai retenu que notre
participation au développement, ne tenait pas au choix des sujets de
recherche mais à celui de nos partenaires. Pour que des connaissances
nouvelles soient utiles au développement, c'est par l'appropriation des
ces connaissances par la société du pays en question, et nous avons le
moyen de faciliter l'émergence de réelles compétences : exigence et
diplomatie, c'est pas facile. Mais tout cela relève de truisme ...
Portez-vous bien et à bientôt François Jarrige
Michel LARDY le 17 Février
Comme
Jacques CLAUDE, dont je partage les commentaires ci-dessus, je n'ai pas
vu tous les messages. Je voulais simplement signaler pour rester dans
l'énergie qu'une expertise collégiale de l'IRD avait été conduite en
2008/2009 sur l'énergie dans le développement de la Nouvelle Calédonie
à la demande du Gouvernement de NC ( le dossier d'expertise est en
ligne sur le site de la Mairie de Nouméa). Les experts sauf un "science
sociale" étaient tous extérieurs à l'IRD, c'est Yves LE BARS du GRED
qui présidait le comité. Il me semble que l'énergie avait figuré au
début des années 2000 dans les objectifs de l'un des départements de
l'Institut (?). Le message de François JARRIGE confirme bien les
tentatives vers des programmes "énergie" sans doute à plusieurs
reprises.
En
NC (où le soleil brille brille brille...) l'objectif n'a pas été de
pomper les retraités mais de conserver un monopole de distribution de
l'énergie autour de grosses centrales (la Société Le Nickel paye
toujours 2 FCFP le KWh (hydro-électrique) et l'abonné 34 FCFP),
subvention déguisée? Les équipements de CES (chauffe eau solaire) sont
seulement de l'ordre de 15% (objectif 20% en 2016) sur l'ensemble du
territoire. Un fabricant local exporte vers la Réunion à un tarif 2
fois plus bas que les CES qu'il vend sur le territoire! L'achat d'un
chauffe eau électrique, comme le fait remarqué Jacques Claude, reste
peu élevé il équipe presque tous les nouveaux immeubles sans qu'aucune
contrainte pour du CES soit imposée aux promoteurs....Il n'y a pas une
réelle volonté de développer les énergies renouvelables (petits
intérêts et puissants lobbies exercent des pressions). La NC avec ses 3
usines de traitement des minerais devrait gagner le peloton de tête par
habitant des pays émetteurs de CO2, elle n'est pas intégrée à la France
pour le protocole de Kyoto.
Ne
pas manquer une animation NASA sur l'évolution climatique depuis 1880 :
youtube.com/watch?v=EoOrtvYTKeE Bien à vous Michel Lardy
Maurice FAY le 17 février
Bonjour,
Discussions fort intéressantes...qui font regretter que le projet d'une
publication collective sur "les recherches pour le développement" n'ait
pas abouti.** De mon regard extérieur et (un peu) pédagogique, je
souligne l'importance de faire distinction entre sciences, recherches
et leurs applications... la confusion peut aboutir aux pires postures
idéologiques !!!
Mais,
je veux surtout remercier (encore une fois et ce ne sera pas assez)
ceux d'entre vous qui sont intervenus auprès des jeunes et des
professeurs. Une voie non négligeable de "développement" ! A noter que,
dans cette activité, j'ai plus entendu parler "d'applications" et
"d'actions de terrain’’ que de "recherches purement scientifiques"...
donc actes !
Et
puis, s’il était nécessaire de soulager une (mauvaise) conscience
orstomo-irdienne, je dirais qu’avec le soleil qui brille, brille,
brille... notre première source d’énergie est l’alimentation (c’est
encore trop peu reconnu …). Sans parler de l’air (pas toujours très pur
!) et de l’eau, si mal répartie… A Toutes et à Tous, je souhaite très
amicalement « bonne santé » :-)) Maurice Fay **
Qui aura le courage d'une synthèse pour "Sciences au Sud" ?
Le nouvel an vietnamien à Hanoï






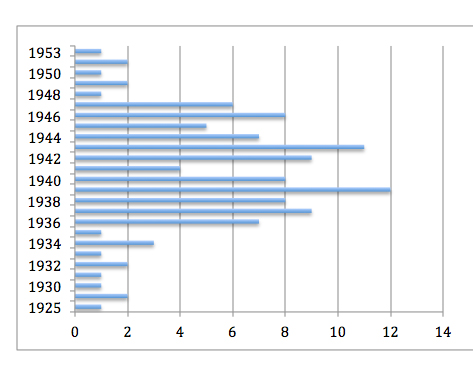


 Conclusions : (rédigées avant les réponse de Claude et Lhoste,
les valeurs moyennes indiquées sont donc légèrement différentes de celles indiquées ci-dessous, mais les
conclusions restent les mêmes).
Conclusions : (rédigées avant les réponse de Claude et Lhoste,
les valeurs moyennes indiquées sont donc légèrement différentes de celles indiquées ci-dessous, mais les
conclusions restent les mêmes).
