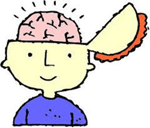|
|
   |
||||||||||
| LE GROUPE AIDA D'HISTOIRE DE L'ORSTOM-IRD |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Relance des activités du groupe histoire en octobre 2019 par C. Feller, au nom du « Groupe Histoire » Lors
de l’Assemblée Générale 2019 de l’AIDA du 4 septembre 2019 à
Aix-les-Bains, l’activité du Groupe Histoire a été évoquée, d’où ce
message de « relance ».
Signalons d’abord qu’un officiel « Comité d’Histoire de l’Orstom-IRD » est censé voir le jour dans le futur et que le groupe Histoire de l’AIDA a d’abord vocation à collecter des documents, de l’iconographie (photos légendées, etc.) et des textes pouvant ultérieurement alimenter de véritables synthèses sur l’histoire de notre institution. Rappelons aussi que le programme initial du Groupe pour l’écriture de textes historiques comprenait deux volets prioritaires : - Éléments d’histoire institutionnelle de 1981 à nos jours, en complément de l’ouvrage historique de Gleizes sur la période 1945-1980. - Éléments d’histoire scientifique de l’institution, avec une première approche disciplinaire (anthropologie, sociologie, océanographie, pédologie, microbiologie, etc.) Quelques membres de l’AIDA s’étaient portés volontaires pour écrire l’histoire de leur discipline. Nous avons eu plusieurs réunions de travail, à la fois pour définir le cadre, mais aussi pour des présentations PowerPoint pour quelques disciplines. Cela partait bien, mais force est de constater que le passage à l’écriture s’est avéré nettement plus difficile qu’attendu vu l’ampleur de la tâche pour rédiger des telles synthèses disciplinaires. Nous proposons donc ci-dessous une approche plus légère et plus ouverte pour collecter, des uns et des autres, de petits textes qui pourront être autant de petites pierres pour un édifice plus important ultérieurement. Il ne s’agit pas ici de textes autobiographiques personnels même si scientifiques, sauf s’il éclairent en grande partie l’histoire de l’institution) Par contre les textes personnels ont un intérêt certain et pourront enrichir les site web AIDA. Appel à textes historiques ou institutionnels sur l’histoire de l’Orstom-IRD
L’appel est : - Totalement ouvert, que ce soit pour des synthèses, ou pour de simples éléments historiques d’une discipline, d’un programme, d’un département, d’une implantation, d’une pratique, etc., - Transversal. Il ne s’agit plus uniquement d’une approche institutionnelle ou disciplinaire, mais totalement ouverte à d’autres perspectives comme mentionnées ci-dessus, - Aussi biographique concernant des textes sur des « grandes figures » de l’Orstom-IRD ou qui ont été liées à l’Orstom-IRD. Dans cette perspective, n’hésitez pas à envoyer des textes déjà écrits, voir publiés ailleurs, mais en les recentrant clairement sur l’histoire de l’Orstom-IRD. Il est probable que certains textes déjà sur le site web AIDA puissent participer, tels quels ou remaniés, à ce programme. Par exemple, pour la pédologie, nous sommes plusieurs (Boulvert, Feller, Colinet, Leprun, Pédro, Chatelin, etc.) à avoir écrit/publié des articles touchant à la pédologie tropicale. Il y aurait un travail à faire pour (i) reprendre si nécessaire des éléments d’histoire Orstom-IRD, ou (ii) tout simplement placer/rappeler ces textes dans la section « Groupe Histoire » du site web AIDA. Je propose une réunion en video du « Groupe Histoire » le mardi 22 octobre 2019 à 10h, à Bondy (salle 225) et à Montpellier (Salle au 1er étage du bâtiment CapMeditrop en haut des escaliers à droite N° 1213) Cette réunion ouverte à tous ceux qui sont intéressés pour tenter cette relance. MERCI D’INDIQUER VOTRE PARTICIPATION A MARIE-NOELLE FAVIER ET CHRISTIAN FELLER (marie-noelle.favier@ird.fr, christian.feller@ird.fr D’ici là, envoyez à Pierre Roger (p.roger@wanadoo.fr) et Christian Feller vos potentielles contributions dans ce que vous avez déjà sous le coude. Réunion du Groupe AIDA d’histoire de l’ORSTOM-IRD du 18 décembre 2014 au Centres IRD de Montpellier.
Réunion
du Groupe AIDA d’histoire de l’ORSTOM-IRD du 27 février 2014 Présents à Montpellier : Jacques CLAUDE, Jean COLLINET, Antoine CORNET, Christian FELLER, Louis PERROIS, Pierre ROGER, Bruno VOITURIEZ Présents à Bondy : Georges COURADE, Roger FAUCK, Marie-Noëlle FAVIER, Michel LARDY, Jacques MERLE, Laurence PORGES Excusés : Benoit ANTHEAUME, Patrice ROEDERER, Patrick SECHET, J.A. VILLE Bruno VOITURIEZ ouvre la séance en présentant l’organisation de la journée. Des documents préparatoires ont été fournis par P. ROGER, G. COURADE et P. SECHET. C. FELLER a proposé la présentation et la discussion des différents points dans l’ordre suivant : - Histoire institutionnelle : C. FELLER - Histoire scientifique : M-N FAVIER - Témoignages personnels : G. COURADE - Archives en possession par l'AIDA : P. ROGER - Organisation pratique du travail a. L’histoire institutionnelle de l’ORSTOM L’ouvrage de Michel GLEIZES sur l’histoire institutionnelle de l’ORSTOM va jusqu’en 1981, une année charnière pour l’ORSTOM avec la transition Guy CAMUS -> Alain RUELLAN qui a amené des changements très importants pour l’ORSTOM, le passage d’un OFFICE à un EPST d’abord, mais surtout l’accent mis officiellement dans le nouveau titre sur le « développement en coopération » et la nouvelle organisation qui en découla. La conservation du sigle montre que ce virage ne s’est pas fait sans résistance en interne comme en externe. C’est l’histoire de cette mutation qu’il serait proposé d’écrire dans un premier temps, d’un point de vue institutionnel, bien sûr mais aussi en intégrant (si témoignages) le point de vue et le ressenti des chercheurs, des partenaires et des ambiances des Centres ORSTOM de l’époque.Après discussion, il a été décidé de se concentrer sur la période A. RUELLAN et de rassembler, classer et mettre en ligne sur le site la documentation ad hoc. Une première analyse de ces documents permettra de faire des propositions dans un document d’orientation d’une trentaine de pages. Sont volontaires pour traiter ce sujet : J. CLAUDE, J. COLLINET, A. CORNET, R. FAUCK, Ch. FELLER, L. PORGES, R. MENU. Documents déjà évoqués pour l’analyse de ce « virage » : - Premières et secondes journées d’études de l’ORSTOM en juin et octobre 82. - « Lettre(s) de l’ORSTOM » de la période A. RUELLAN. - Les comptes rendus du Conseil d’administration dans les archives de l’IRD à Fontainebleau. - Des rapports d’activité des centres dont Régis Menu a conservé une bonne partie. b. L’histoire scientifique de l’Orstom/IRD C’est le cœur du sujet : raconter les apports scientifiques de l’ORSTOM/IRD. Il ne s’agit pas de faire une œuvre épistémologique exhaustive tant les champs disciplinaires, les questionnements transversaux, les localisations, les échelles spatiales sont variés. Aussi, dans un premier temps, on s’intéressera aux disciplines en insistant, plus particulièrement, sur l’analyse de l’évolution de la discipline concernée :- dynamique propre de la discipline, - apports scientifiques et méthodologiques originaux, - émergence de nouveaux concepts, - passage de la culture d’observatoires et d’inventaires à l’analyse dynamique, - insertion dans les contextes national et international. Parallèlement, si des candidats sont disponibles, on pourra aborder quelques grands thèmes ou projets transversaux ou observatoires communs qui ont fait converger plusieurs disciplines : paludisme, climat, projet onchocercose, observatoire de Niakhar… Au départ, les travaux seront disparates et ce n’est qu’ensuite que nous pourrons essayer d’organiser l’ensemble. Pour commencer, il est décidé de se focaliser sur quelques disciplines : Pédologie : J. COLLINET, C. FELLER Géographie : G. COURADE Hydrologie : J. CLAUDE Ecologie : A. CORNET Ethnologie : L. PERROIS Microbiologie des sols : P. ROGER Océanologie : J. MERLE et B. VOITURIEZ Ces membres produiront des textes généraux qui ne devraient pas dépasser une quinzaine de pages, mais qui pourront être enrichis, par la suite, avec des approches plus spécifiques. c. Histoires personnelles Il est proposé un canevas pour que ces histoires personnelles fassent sens au niveau global et soient publiables et lisibles par un public éclairé et intéressé.1. Conditions intellectuelles de travail Avant 1981 il s’agissait surtout d’un travail contractuel (inventaire, carte, rapports à réaliser). La question du partenariat n’est apparue officiellement qu'après 1984. Après 1983, un travail partenarial avec les équipes de Sud ou des collègues du nord est devenu plus ou moins obligatoire. La pluridisciplinarité est aussi devenue à certaines périodes une obligations vécue plus ou moins bien, avec des rapports de domination explicites ou implicites, des incompréhensions, des méthodologies difficiles à mettre au point, des modes d'évaluation contradictoires ( individuels plutôt que collectifs), des rapports ingénieurs-chercheurs, etc. 2. Contraintes idéologiques globales Les orientations scientifiques ont été progressivement définies. Il y eut d'abord des recherches appliquées (mise au point d'outils, d'inventaires et de savoirs pour le développement dans les centres, laboratoires, stations et sur le terrain). Le développement devint aussi un objet scientifique (recherches sur le développement analysant les projets et les politiques publiques ou solidaires utilisant les outils mis au point par la recherche auprès par exemple des agriculteurs ou des patients). Dans un troisième temps, le développement a été encore redéfini de manière normative (développement durable ou humain, croissance inductive, etc.) suite aux résultats obtenus par les recherches précédentes si bien que la Communauté internationale a lancé des « Décennies du développement » qui ont orienté et interagi sur nos recherches. 3. Contextualité matérielle, familiale et politique très évolutive de votre récit de vie
4. Mobilisation de documents de base pour élaborer les histoires individuelles
Les témoignages personnels doivent apporter prioritairement une information complémentaire à vos publications, faire connaître une littérature grise ignorée ou déconsidérée ou apporter un éclairage scientifique sur des questions de fond sans règlement de compte, mais avec le souci de montrer par exemple qu'un évènement plutôt de type privé vous a conduit à faire un grand récit scientifique sur le foncier ou les mythes d'origine en sciences sociales. Des collègues vivant avec des Peules par exemple ont découvert un univers monadique et culturel qu'ils ne connaissaient pas. Décision : Les membres présents à la réunion se donnent un mois pour faire quelques propositions de thèmes qui permettront de lancer des appels à contributions par des extraits des récits de vie. d. Archives orales M.N. FAVIER indique que l’INRA a mis en place un processus pour la récolte d’archives orales. Nous pouvons, dans un premier temps, faire une liste de personnes susceptible de conduire ce type d’interview et de personnes à interviewer. Mais il semble quelque peu prématuré de se lancer actuellement dans cette activité. Voir en annexe un document adapté d’un guide réalisé par le département FLHOR du CIRAD pour organiser la restitution de l’histoire des chercheurs. M-N. FAVIER pourra proposer une trame type, simplifiée.e. Colloques, publications L’organisation de colloques et publications spécifiques n’est, pour l’instant, guère envisageable.En revanche, il est possible de présenter l’histoire générale des disciplines (voir point b.) dans des colloques spécialisés. Si, en 2014 ou 2015, l’IRD organisait un colloque anniversaire pour ses 70 ans, l’AIDA pourrait y participer. À Nouméa, il est prévu une célébration des 70 ans de l’ORSTOM en fin d’année à laquelle l’AIDA pourrait probablement apporter une contribution, en particulier sur l’océanographie, voire les changements climatiques. f. Textes publiées et en cours de publication La liste des textes sur l’histoire de l’ORSTOM-IRD disponibles sur le site Web de l’AIDA est annexée. F. COLMET-DAAGE est en train de faire scanner son manuscrit et les illustrations à Bondy. Le document sera ensuite disponible sur la base Horizon en version PDF. Le gendre de B. LEPOUTRE est entrain de saisir le texte de B. LEPOUTRE et la correspondance avec sa mère. Il indique : « Par ailleurs Bernard cite de nombreux noms de chercheurs et autres personnalités, pour lesquels un lexique sera également ajouté en fin de texte. Des documents photographiques, saisis par Bernard lui-même sont également ajoutés au texte. J'espère que d'ici l'été prochain l'ensemble pourra être édité ». g. Mise à disposition de ces textes Les témoignages peuvent susciter des controverses et doivent être soumis à modération. Non qu’il faille éviter la controverse mais il faut s’assurer qu’elle reste suffisamment courtoise et civilisée.À priori, dans un premier temps, les textes peuvent être placés sur le site. Voir « évolution du site » dans le compte rendu du CA. P. ROGER propose de réorganiser les pages concernant ce thème pour inclure : 1. Une section présentant l’activité du groupe histoire de l’AIDA (déjà présente), 2. Une page sur l’avancement de l’histoire institutionnelle de l’IRD pour la période 1980-… 3. Une section bibliographie (déjà présente mais à réorganiser avec un moteur de recherche), avec téléchargement des textes disponibles en PDF. 4. Une section images avec la possibilité d’y faire figurer des présentations commentées de photographies des anciens. h. Organisation du groupe • Maintien du triumvirat G. COURADE, C. FELLER, M-N. FAVIER pour l’animation (suivi et relances).• Identifier des collègues hors AIDA susceptibles de rédiger des synthèses. • Faire un bilan à l’automne 2014. • Prochaine réunion : 13 novembre à 10h en visioconférence Montpellier-Bondy. ANNEXES ANNEXE 1 : TEXTE FONDATEUR Remarque préliminaire Pour distinguer notre projet du projet institutionnel de Comité d’Histoire de l’IRD, nous utiliserons le terme « Groupe » pour l’association AIDA et « Comité » pour l’institution IRD. Il a donc été décidé la création d’un « Groupe AIDA d’Histoire de l’IRD (AIDA-H) ». La mise en place et l’animation du Groupe AIDA-H sont sous la responsabilité de Georges COURADE, Marie-Noëlle FAVIER et Christian FELLER. Les animateurs proposent comme actions à très court terme : - la diffusion générale d’un mail sur la création d’un "Groupe AIDA d'Histoire de l'IRD" en rappelant le texte initiateur (annexe 3) (FAIT) ; - l’organisation le 27 février une réunion de travail préparatoire sur l’histoire de l’ORSTOM/IRD, en même temps que la prochaine réunion du CA.) (FAIT) ; Nous rapportons ici quelques idées émises au cours des diverses discussions et comptes rendus de celles-ci (présentés à la Direction Générale et Présidence de l’IRD, de 2010 à 2012) en vue de la création d’un Comité d’Histoire de l’IRD, projet actuellement entre les mains du Conseil Scientifique de l’IRD. 1. Publications Proposer un schéma général de publications sur l’histoire de l’IRD : a) en première priorité, on peut d’ores et déjà envisager : - un ouvrage (ou une plaquette) complémentaire à l’ouvrage de M. GLEIZES sur l’histoire institutionnelle de l’IRD pour la période 1980-2010 ; - un ouvrage général sur l’histoire scientifique de l’IRD qui pourrait avoir des entrées disciplinaires : Sciences de la Terre, Sciences du Vivant, Sciences Sociales, Humaines et Santé. b) en seconde priorité ou parallèlement : - l’histoire scientifique de l’Orstom/IRD et de ses partenaires pour quelques grandes implantations géographiques où l’IRD est encore bien représenté (par ex. le cas du Brésil, de la Tunisie, du Sénégal, de Nouvelle-Calédonie, etc.), en co-montage avec des chercheurs nationaux de ces pays ou régions et sous la responsabilité du représentant local de l’IRD ; - l’histoire scientifique sur des grands champs thématiques transversaux. 2. Colloques, célébrations d’évènements Le Comité a vocation à organiser des Colloques : - sur l’histoire de la science au Sud ; - ou autour de grandes figures historiques de la science au Sud. 3. Archives orales Certaines institutions comme l’INRA ont mis en place le recueil d’archives orales auprès de grands scientifiques ayant marqué l’institution. Ceci pourrait aussi constituer une activité à organiser par le Comité d’histoire de l’IRD. Voir en annexe un document adapté d’un guide réalisé par le département FLHOR du CIRAD pour organiser la restitution de l’histoire des chercheurs. Les animateurs vous enverront un premier canevas de réflexion et de programmation prochainement. qui pourra ainsi être discuté au cours de cette réunion virtuelle. Manifestez-vous déjà si vous avez quelques idées de travail et de publication sur ce large thème, même si cela vous paraît une contribution réduite. Vous avez dû apprendre que le Conseil Scientifique de l'IRD trouve intéressant la création d'un Comité d'Histoire à l'IRD et devrait faire une proposition au Président de l'IRD.Àce niveau-là, des historiens des sciences seront surement contactés, mais l'AIDA peut apporter sa contribution informelle à travers nos écrits de non-spécialistes. N'hésitez donc pas à contacter les organisateurs (Georges COURADE, Marie-Noëlle FAVIER et Christian FELLER). ANNEXE 2. PROPOSITIONS DE PATRICK SECHET POUR LA RÉDACTION DE L’HISTOIRE DE L’IRD Je crois tout d'abord que ce serait bien de ne pas remonter au-delà de 1981, date butoir du rapport de Michel Gleizes d'une part et aussi date de départ de la réforme Ruellan. De l'autre côté, on pourrait aller jusqu'à l'entrée de Michel Laurent come directeur général, courant 2006 si je ne m'abuse, ce qui ferait au total un quart de siècle d'histoire de notre institution. En ce qui concerne les documents institutionnels à exploiter, je suis un peu sceptique sur l'intérêt des bulletins internes de la vie de l'institut, lesquels ont toujours été constitués d'une mosaïque d'articles qui ne sont que très peu centrés sur le cœur des mutations subies par l'organisme. L'idéal serait de s'appuyer sur les relevés de conclusions des comités de direction, mais je crains qu'il n'en existe que très peu (période Winter, essentiellement). Les comptes rendus du conseil scientifique peuvent être intéressants (il a été mis en place dès 1984 et il en existe des officiels et des officieux), mais plutôt pour votre point 2 que pour le point 1. Il me semble en fait que le document qui serait le plus utile est le procès-verbal du conseil d'administration : il existe depuis toujours, il y en a trois ou quatre par an et il est religieusement conservé par le Secrétariat général de l'institut, en raison d'obligations statutaires, j'imagine. Il me semble qu'en termes de contenu il devrait y avoir ce qu'il nous faut (le CA débute généralement par un discours du président et du DG sur la situation et les activités de l'institut, qui est très succinctement relaté dans le PV) et les sujets qui y sont traités concernent les grands événements qui touchent l'institution. Ce que je ne sais pas c'est si on peut y avoir accès, mais je suppose qu'il suffirait d'en faire la demande auprès du président. C'est peut-être le moment ou jamais de le solliciter. Si vous décidez de le faire, je suppose qu'il conviendra de garantir des limites à l'utilisation, car il me semble que ce ne sont sûrement pas des documents à laisser traîner sur le web, même trente ans après ! En espérant avoir été un peu utile. Très cordialement, Patrick Séchet, depuis Brasilia. ANNEXE 3 : THÈMES STRUCTURANT L’HISTOIRE D’UNE VIE PROFESSIONNELLE (Texte adapté d’un document réalisé par le département FLHOR du CIRAD) 1. En début de carrière Votre formation précédant votre premier emploi était-elle déjà orientée en fonction d’un choix de métier ?Votre motivation à débuter votre vie professionnelle dans un institut de recherche « Outre-Mer » • Attrait scientifique : recherche sensu stricto, recherche appliquée, recherche pour le développement • Attrait technique : appui au développement • Attrait du Sud : Outre-Mer français, colonies, pays du sud … Aventure, découverte • Attrait coopération : opportunité d’échapper au service militaire, objectif humanitaire social ou culturel • Attrait financier : 3e année payée, brochure ORSTOM !!! • Autres : 2. En cours de carrière Dans quel contexte avez-vous exercé votre métier et vos fonctions c’est à dire les éléments ou évènements ayant interagi sur votre vie professionnelle et personnelle, particulièrement Outre-Mer.Après quelques lignes caractérisant votre premier contrat (civil ou VSN), premier déménagement et première installation Outre-Mer, développer les événements d'ordre : Politique : Avant l’indépendance des états africains et malgaches - effet deuxième guerre mondiale. Après l'indépendance : stratégie d'aide au développement française, européenne, internationale, émergence de systèmes nationaux de recherche. Contexte politique, coups d'état en Afrique. Autres. Géographique : Eloignement, Isolement. Voies et moyens de transport, de communication. Budgétaire : Abondance ou rareté : des moyens financiers votés ou ressources propres (contractuel venant de produits), des équipements de laboratoire, agricole, terrains expérimentaux. Économique : Cours des produits agricoles à l'exportation. Coût et disponibilité des intrants. Environnementales et climatiques : Effet des saisons (pluie, sécheresse). Effet des cyclones, inondation, tremblement de terre, éruptions volcaniques. Partenarial : Relations avec les administrations locales, organisations professionnelles, bailleur de fonds (AFD, BM, FED, FAC, PNUD, etc.). Relations avec les institutions nationales, régionales, internationales (CGIAR, FAO, CATIE, etc.) Sociale et ressources humaines : Relation avec l'équipe locale et les collègues étrangers, la hiérarchie locale, la hiérarchie métropolitaine, les stagiaires, les VAT, les VSN. Formation : Réalisation d'une thèse ou autre, Encadrement de thèse, enseignement, vulgarisation. Managérial : Problèmes lié à la gestion d'une structure de recherche outre-mer, aux mutations intra ou extra ORSTOM-IRD, aux mutations fréquentes. Familial: carrière du conjoint, éducation des enfants, santé, approvisionnement, loisirs, culture, logement, congés. Sécuritaire : Problèmes liés à la sécurité des biens et des personnes outre-mer Autres : ex. voyages 3. En fin de carrière, soit outre-mer, soit en métropole Développer le contexte en termes :D'épanouissement, capitalisation, publications, expertise, formation, De frustration, difficultés d'adaptation, de reconversion, nostalgie du Sud, Changement de structures d'accueil intra ou extra ORSTOM-IRD, fusion des départements, UR, UMR… 4. Evénements très marquants (un à cinq) Citer et développer un nombre restreint d'événements qui ont particulièrement marqué votre vie professionnelle (même s'il y a redondance avec ce qui précède).Parmi les événements spécifiques, pourraient être développés ceux relevant de mission ayant trait : • Aux prospections : ressources génétiques, inventaire botanique, pédologique, enquêtes de terrain…. • Aux inventaires : parasites et ravageurs. • Aux démarches : projet, clients, partenaires, bailleur de fonds. • Aux études et réalisations de projets à faisabilité douteuse. Distinguer les événements actions ayant généré chez vous ou chez vos partenaires et collègues une grande satisfaction ou émotion positive, des événements ayant généré chez vous déception, amertume, colère, ou regret, etc. 5. Personnages très marquants (un à cinq) Citer, présenter et dire comment, quand et où et pourquoi certains personnages ont eu un rôle déterminant sur le déroulement de votre carrière.6. Les partenaires et collègues du Sud Citer quelques partenaires collègues collaborateurs, chercheurs développeurs, paysans, chef d'entreprise, préfet, ministre, qu'il vous serait agréable de mettre en valeur dans le cadre de ce projet. Si certains sont d'accord et joignables, nous pourrions aussi les faire parler pour avoir leur vision, leur rapport ou leurs critiques sur l'histoire et la mémoire des hommes de l’ORSTOM-IRD (transmettre leurs coordonnées) 7. Le rôle particulier des femmes Dans un contexte historiquement dominé par les hommes, les femmes ont certainement un particularisme à faire valoir, mettant en valeur leurs difficultés, réussite, de sensibilité, leur influence, etc.8. La liaison passée-présent Vos réflexions sur l'évolution : 9. Autres Dans cette rubrique n'hésitez pas à rapporter des anecdotes de tous ordres, drôles ou humoristiques et des d'événements qui vous ont particulièrement marqué.ANNEXE 4: LES TEXTES DISPONIBLES ET A RECHERCHER Textes disponibles sur le site web de l’AIDA N.B. Les 29 références marquées OK sont téléchargeables sous forme de document PDF.Les trois références non disponibles à partir du site sont en italique. 1. Allorge L. , Roederer P (????) Apport des scientifiques français à la recherche scientifique à Madagascar, passé et présent. 12 pp. multigraphié OK (disponible sur le site en version texte) 2. Anon. (1983) Profession : géographe : pratique de la recherche tropicale ORSTOM, 160 p. OK 3. Baruch J-0 (1997) L'orstom en quête d'une nouvelle identité. La recherche mensuel n°298 page 31. OK 4. Bied-Charreton M. (2013) L’ORSTOM, puis l’IRD : les étapes décisives de l’histoire de l’ORSTOM devenu IRD et ma place dans cet institut. OK 5. Bonneuil C., Petitjean P. (1996) Les chemins de la création de l'ORSTOM, du Front populaire à la Libération en passant par Vichy, 1936-1945 : recherche scientifique et politique coloniale, in Waast Roland (ed.), Petitjean P. (ed.). Les sciences hors d'Occident au 20ème siècle : 2. Les sciences coloniales : figures et institutions. ORSTOM éditions , 2/7, p. 113-161. OK 6. Bonneuil C (1990) "Des Savants pour l'Empire: les origines de l'ORSTOM", Cahiers pour l'histoire du CNRS. 1939-1989, n° 10 (1990), 83-102 OK. Voir aussi : http://www.laprocure.com/savants-pour-empire-structuration-recherches-scientifiques-bonneuil/9782709910699.html 7. Charmes Jacques (ed.). (1997) Mille et une histoires Outre-Mer : ballade pour un recueil de souvenirs à l'occasion du cinquantenaire de l'Orstom, ORSTOM, 347 p. OK 8. Clignet Rémi (1997) Un sociologue entre Afrique et Etats-Unis : trente ans de terrains comparés. Karthala, ORSTOM, 227 p. (Hommes et Sociétés) OK. 9. Courade Georges (2007) Géographe ORSTOM-IRD dans une Afrique en mouvement . Revue Tiers-Monde - N° 191 (JUILLET-SEPTEMBRE). OK 10. Couty Philippe (1985) Trente ans d'anthropologie économique chez les économistes de l'ORSTOM (1954-1984) p. 11-20. In Approche anthropologique et recherche économique à l'ORSTOM: ORSTOM, (Colloques et Séminaires) OK. 11. Couty Philippe (1988) Un itinéraire de recherche : Claude Robineau. Source Cahiers des Sciences Humaines, 1988, 24 (4), p. 443-452. OK 12. Couty Philippe (1990) Vingt-cinq ans de recherche sur les agricultures africaines : cahiers ORSTOM, série Sciences Humaines , 1963-1987. Cahiers des Sciences Humaines, 1990, 26 (3), p. 343-363. OK 13. Feller Christian et Sandron Philippe (2010) Parcours de recherche à Madagascar. L'IRD-ORSTOM et ses partenaires. 423pp + DVD. IRD Editions (voir à la page"Publications et nouvelles") Disponible en lecture à l’écran sur : ooks.openedition.org/irdeditions/5322 14. Gentil Dominique (1986) Du développement à la recherche : à propos d'un itinéraire personnel. In Dynamique des systèmes agraires : l'exercice du développement Source Paris : ORSTOM, 1986, p. 339-350. (Colloques et Séminaires). OK 15. Gleizes Michel, Lavau Pierre, Ruellan Alain (1985) Un regard sur l'ORSTOM 1943-1983 : témoignage, ORSTOM pub., 122 p. OK 16. Guillaud Dominique (ed.), Seysset M. (ed.), Walter Annie (ed.) (1998) Le voyage inachevé... à Joël Bonnemaison, ORSTOM, 776 p. OK 17. Hervy Jean-Paul, Garulli Frédérique, Brunhes Jacques, Geoffroy Bernard (1994) Les entomologistes médicaux de l'ORSTOM et la diversité du vivant : un demi-siècle de descriptions d'espèces nouvelles, ORSTOM (Etudes et Thèses), 78 p. OK 18. Leprun Jean-Claude (coord.) (1994) ORSTOM-Brésil : trente ans de coopération scientifique, ORSTOM, 559 p. OK 19. LEPRUN Jean-Claude (2010) Terrains de recherche. Chroniques du quotidien d'un scientifique. Brousse africaine, tanety malgache et sertao brésilien, 1967-2001. Éd. de l’Harmattan, Coll. Terrain récits & fictions, 324 p. (voir à la page"Publications et nouvelles") 20. Marguerat Yves, Pélei T. (1996) "Si Lomé m'était contée" : dialogues avec les vieux loméens Presses de l'Université du Bénin, 355 p. OK 21. Perrois Louis. (1997) Patrimoines du sud, collections du nord : trente ans de recherche à propos de la sculpture africaine (Gabon, Cameroun) ORSTOM, 123 p. OK 22. Perrois Louis (1994) Sciences et société : 50 ans (et plus) de dialogue à l'ORSTOM. Mondes et Cultures, 44 (2-3-4), p. 237-255. OK 23. Perrois Louis , Monnet Claude, Lissalde Claire (1994) Images et visages : l'ORSTOM a cinquante ans, ORSTOM pub. , 233 p. (pas de pdf.) 24. Petitjean P. (décembre 1998) LES SCIENCES HORS D'OCCIDENT AU XXE SIECLE, V2 : LES SCIENCES COLONIALES... IRD ORSTOM , collection SHO , 25. Postel Emile (1958) Essai de tourisme géologique : l'ascension du Piton de la Fournaise ORSTOM, Littérature grise 8 p. multigr. OK 26. Roederer Patrice (1998) 20000 lieues sur les mers : la marine ORSTOM : souvenirs rassemblés par Patrice Roederer, ORSTOM pub. , 121 p. OK 27. Sabrié Marie-Lise (1996) Histoire des principes de programmation scientifique à l'ORSTOM (1944-1994) In Waast Roland (ed.), Petitjean P. (ed.). Les sciences hors d'Occident au 20ème siècle 2. Les sciences coloniales : figures et institutions ORSTOM, 1996, 2/7, p. 223-234. OK 28. Sebillotte M (1993) Epistémologie, agronomie et formation : regards sur l'oeuvre de Stéphane Hénin. In Mélanges offerts à Stéphane Hénin : sol - agronomie – environnement Jubilé Scientifique Source ORSTOM , p. 149-179 OK. 29. Tall Emmanuelle (1992 L'anthropologue et le psychiatre face aux médecines traditionnelles : récit d'une expérience. In Gruénais Marc-Eric (ed.), Dozon Jean-Pierre (ed.). Anthropologies et santé publique. Cahiers des Sciences Humaines, 1992, 28 (1), p. 67-81. OK. 30. Waast R. (décembre 1998) LES SCIENCES HORS D'OCCIDENT AU XXE SIECLE V6 : LES SCIENCES AU SUD,... IRD ORSTOM , collection SHO , 31. Winter Gérard (1990) ORSTOM, le projet d'établissement, ORSTOM, 36 p. OK 32. Winter Gérard (2010) À la recherche du développement, un fonctionnaire au service d’une passion. KARTHALA pub. (voir à la page"Publications et nouvelles") Références indiquées par Y. Boulvert • avril 1945, une brochure de 23 pages sur Office de la Recherche Scientifique Coloniale, • séance du 15 novembre 1946 de l'Académie des Sciences Coloniales, professeur Combes : Office de la Recherche Scientifique Coloniale, p.527-546. • séance du 22 mai 1953 de l'Académie des Sciences Coloniales, discours de réception du professeur Combes par Charles Jacob, p.223-240, • Comptes rendus de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer : • séance du 18/03/1976 : G. Aubert: pédologie française • séance du 01/10/1976 : G. Camus : l'ORSTOM en Afrique, • séance du 05/11/1976 : G. Mangenot : La recherche botanique en Afrique, • séance du 19/11/1976 : J.L. Mestraud : La recherche géologique en Afrique, • séance du 03/12/1976 : J. Cabot : La recherche géographique en Afrique, • séance du 04/03/1977 : J. Pajot : La recherche agronomique en Afrique, • séance du 15/06/1979 : Réception de G. Camus par G. Mangenot • séance du 16/03/1984 : A. Ruellan: l'ORSTOM, • séance du 03/01/1986 : G. Aubert, président de l'ASOM, • séance du 20/11/1987 : Les instituts Pasteur Outre-Mer • séance du 19/05/1990 : M. Levallois, La Coopération scientifique française, • Réception d'A. Ruellan ... Autres références • Beaufrère (1955) La recherche scientifique dans les territoires du Tchad et du Nord Cameroun in L'Afrique française: bulletin mensuel du Comité de l'Afrique Française et du Comité du Maroc• Historique de la Recherche Agricole au Congo (http://www.mrsit-congo.net/histoire.php) • Texte sur 25 anniversaire de la création du centre de Montpellier (Jacques CLAUDE). • Il faudrait aussi retrouver les rapports de centre et les audits de l’institution et des départements • Un document web élaboré à l’occasion du 25ème anniversaire du centre de Montpellier devrait être très bientôt disponible sur l’intranet du centre IRD-Sud (contact: Valérie Rotival) |
|||||||||||
|
|||||||||||